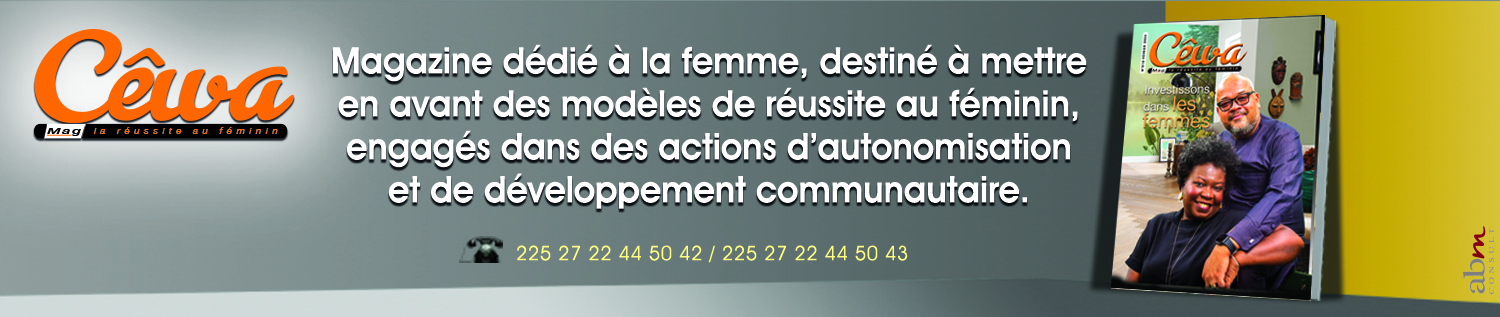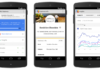L’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024, publié par Transparency International, dresse un tableau contrasté de la gouvernance en Afrique subsaharienne. Si certains pays enregistrent des progrès notables, d’autres reculent sous le poids d’une corruption persistante, illustrant les défis structurels qui freinent la transparence et le développement économique.
Dans une région où la corruption est souvent pointée comme l’un des principaux obstacles aux investissements et à la croissance, ces évolutions sont scrutées de près par les institutions financières internationales et les acteurs économiques. Mais ces résultats traduisent-ils de véritables avancées ou des améliorations conjoncturelles ?
Des avancées encourageantes, mais fragiles
Certaines nations se démarquent par des efforts visibles en matière de lutte anticorruption.
La Côte d’Ivoire, avec un score de 45, progresse de 10 points depuis 2019. Cette amélioration est attribuée à des réformes institutionnelles visant à renforcer la transparence, notamment par la modernisation des procédures administratives et la création d’organes de contrôle plus indépendants. Toutefois, des critiques persistent sur l’application inégale des lois et les interférences politiques dans certaines affaires.
Les Seychelles enregistrent un score de 72, soit une hausse de 20 points depuis 2012. Ce succès repose sur une politique proactive de poursuites judiciaires contre des affaires de corruption de grande ampleur, ainsi que sur un renforcement des mécanismes de transparence dans la propriété des entreprises. Selon un rapport de la Banque mondiale, cette évolution a contribué à un climat des affaires plus attractif, limitant les flux financiers illicites.
En Tanzanie, la lutte anticorruption semble s’intensifier, avec un score de 41, en hausse de 10 points depuis 2014. Le gouvernement a instauré un tribunal spécialisé pour juger les crimes économiques, et des mesures disciplinaires plus strictes visent les fonctionnaires impliqués dans des malversations. Cependant, des ONG locales soulignent encore un manque d’indépendance judiciaire, qui pourrait freiner les progrès sur le long terme.
Un recul inquiétant dans plusieurs pays
À l’inverse, plusieurs États enregistrent des baisses notables, illustrant un affaiblissement des garde-fous institutionnels et une détérioration de la liberté de la presse et de la société civile, pourtant essentielles dans la lutte anticorruption.
Le Lesotho a perdu 12 points en dix ans, avec un score de 37. Cette chute est attribuée à une répression accrue des journalistes et des organisations indépendantes, réduisant la capacité de dénonciation des abus.
L’Eswatini subit un recul encore plus marqué, avec une baisse de 16 points sur la même période (score actuel de 27). Un rapport du Comité des comptes publics a révélé des dépenses publiques non autorisées à grande échelle, impliquant plusieurs ministères. La Commission anticorruption, critiquée pour son inefficacité, n’a pris aucune mesure concrète contre ces irrégularités.
Le Gabon et le Liberia ont chacun perdu 10 points depuis 2014 (score actuel de 27), mais des changements récents pourraient influencer la trajectoire future.
Au Gabon, le coup d’État d’août 2023, qui a mis fin à 56 ans de régime monofamilial, a entraîné des promesses de réformes anticorruption de la part des nouvelles autorités. Reste à savoir si ces engagements seront suivis d’effets concrets.
Au Liberia, le président Joseph Boakai, élu en janvier 2024, a déclaré son patrimoine et lancé des audits des principales institutions étatiques, y compris la Banque centrale. Une initiative saluée par la société civile, mais dont les résultats devront être mesurés à l’épreuve du temps.
Comprendre l’Indice de Perception de la Corruption
L’IPC, établi par Transparency International, classe 180 pays et territoires sur une échelle de 0 à 100, où 0 représente une corruption généralisée et 100 une transparence quasi totale.
Ce classement repose sur 13 sources indépendantes, dont celles de la Banque mondiale, du Forum économique mondial et d’instituts spécialisés, en s’appuyant sur les perceptions d’experts et d’acteurs économiques plutôt que sur l’opinion publique.
Des efforts à intensifier pour un changement durable
L’édition 2024 de l’IPC montre que si des progrès sont possibles, ils restent fragiles et soumis aux aléas politiques. Dans plusieurs pays, les avancées restent dépendantes de la volonté des dirigeants en place, sans garanties de pérennité.
La lutte contre la corruption ne peut se limiter à des réformes institutionnelles : elle exige une justice indépendante, une presse libre et une société civile active. Sans ces piliers, les améliorations observées risquent de s’effacer au gré des alternances politiques.
L’enjeu est clair : les gouvernements africains sauront-ils transformer ces progrès en réformes structurelles durables, ou ces évolutions resteront-elles de simples embellies temporaires ?