Les prix des matières premières entament un repli qui pourrait marquer un tournant durable. Selon la Banque mondiale, les cours globaux devraient chuter de 12% d’ici fin 2025, puis de 5% supplémentaires en 2026, atteignant ainsi leur plus bas niveau depuis six ans. Si cette tendance annonce un apaisement des tensions inflationnistes, elle soulève aussi de sérieuses inquiétudes pour les économies exportatrices, notamment dans les pays en développement.
Un cycle haussier qui touche à sa fin
Portés par la reprise post-pandémie et les perturbations liées à la guerre en Ukraine, les prix des matières premières avaient connu un envol spectaculaire entre 2020 et 2022. Cette flambée a offert un répit budgétaire aux pays producteurs, en particulier africains, en dopant leurs recettes d’exportation. Mais cet épisode semble désormais révolu. La Banque mondiale prévoit un recul net de l’ensemble des prix, corrigés de l’inflation, en dessous des moyennes observées entre 2015 et 2019. En clair, le super-cycle touche à sa fin, emportant avec lui les bénéfices de rente engrangés ces dernières années.
Une inflation qui reflue, mais à quel prix ?
À court terme, cette baisse constitue une bonne nouvelle pour les pays importateurs, en particulier ceux qui dépendent fortement de l’énergie. Après avoir atteint des sommets en 2022, les prix du pétrole et du charbon devraient respectivement reculer de 17% et 20% en 2025. Le baril de Brent, aujourd’hui autour de 81 dollars, pourrait glisser jusqu’à 60 dollars d’ici 2026. Ce reflux atténue les pressions inflationnistes, contribuant à stabiliser les prix à la consommation dans de nombreuses économies.
Mais ce soulagement reste relatif. Car dans l’autre camp, celui des producteurs, l’impact est beaucoup plus brutal. Deux tiers des pays à faible revenu dépendent étroitement des exportations de matières premières pour financer leurs budgets et alimenter leurs réserves de change. La baisse des cours équivaut pour eux à une ponction directe sur leurs marges de manœuvre. Pire : la volatilité actuelle, que la Banque mondiale juge plus élevée qu’à aucun moment depuis les années 1970, complique la planification économique.
Des mutations structurelles à l’œuvre
Au-delà des facteurs conjoncturels, la tendance baissière s’inscrit aussi dans un changement plus profond. La demande mondiale de pétrole ralentit structurellement, sous l’effet conjugué de la transition énergétique, du développement des véhicules électriques et de la stagnation de la croissance dans les grandes économies émergentes. En Chine, par exemple, près d’une voiture neuve sur deux vendue en 2024 est désormais électrique ou hybride. Or ce pays reste, de loin, le premier moteur de la demande mondiale en matières premières.
L’offre, elle, ne faiblit pas au même rythme. Les investissements dans de nouveaux projets miniers et énergétiques, amorcés durant le boom des prix, continuent d’alimenter les marchés. Ce déséquilibre structurel accentue la pression à la baisse sur les cours.
Paradoxes et angles morts
Les denrées alimentaires ne sont pas épargnées. Après plusieurs années de hausse, les prix agricoles mondiaux devraient reculer de 7 % en 2025. Mais ce reflux ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de la sécurité alimentaire. Selon le Programme alimentaire mondial, 170 millions de personnes restent menacées par la faim, en particulier dans les zones de conflits. Car même à prix mondiaux modérés, les problèmes d’accès, de logistique et de pouvoir d’achat local persistent.
Autre paradoxe : alors que la plupart des matières premières reculent, l’or, valeur refuge par excellence, poursuit sa progression. Dopé par l’instabilité géopolitique et la demande des banques centrales, son prix pourrait atteindre un nouveau record en 2025. À l’inverse, les métaux industriels — cuivre, aluminium, nickel — subissent le contrecoup du ralentissement chinois, de la baisse de la demande manufacturière et des tensions commerciales persistantes entre grandes puissances.
Quels choix pour les pays en développement ?
Dans ce contexte complexe, la Banque mondiale invite les économies vulnérables à s’adapter rapidement. Trois axes sont mis en avant : assainir les finances publiques, stimuler les échanges commerciaux et renforcer l’attractivité pour les capitaux privés. Des recommandations classiques, mais qui se heurtent à une réalité de terrain difficile. Avec une dette publique en hausse, des taux d’intérêt élevés et des besoins sociaux croissants, la mise en œuvre de réformes structurelles devient plus ardue.
À cela s’ajoute un autre défi : la brièveté des cycles. Entre 2020 et 2024, les alternances haussières et baissières des prix ont été deux fois plus rapides qu’au cours des décennies précédentes. Cette instabilité chronique rend la prévision budgétaire incertaine et affaiblit la portée des politiques économiques.
Vers une ère de volatilité permanente ?
Loin d’un simple ajustement ponctuel, le repli actuel des matières premières pourrait bien signaler l’entrée dans une nouvelle ère, marquée par une instabilité durable. Entre chocs climatiques, tensions géopolitiques, transition énergétique et bouleversements économiques, les marchés semblent condamnés à des fluctuations plus fréquentes et plus brutales.
Pour les pays du Sud, la leçon est claire : le modèle de développement fondé sur l’exportation de matières premières brutes montre ses limites. La diversification des économies, le développement de chaînes de valeur locales et l’investissement dans les infrastructures restent les clés pour amortir les chocs à venir.

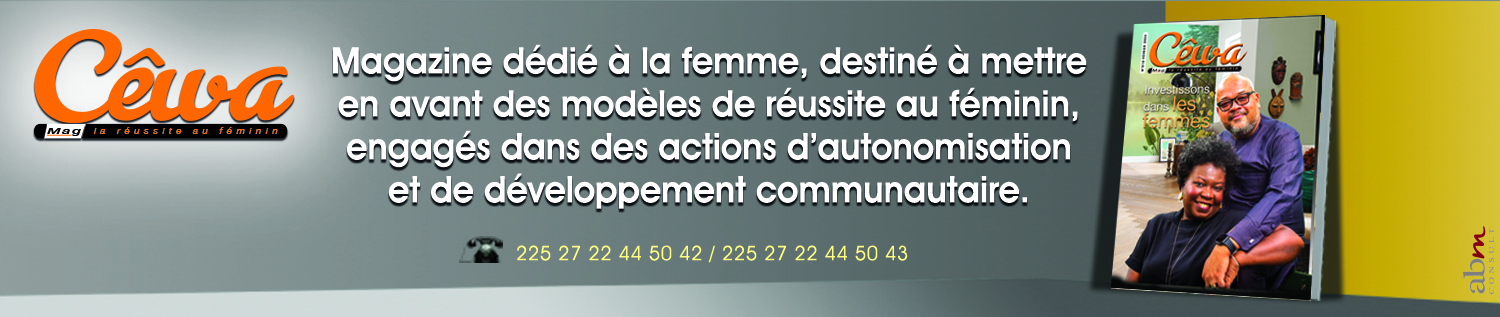






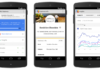




cvkyyh
Уютная обивка утратила былй лоск? Химчистка мебели на дому в городе на Неве! Вернем диванам, креслам и коврам их истинную красоту. Экспертные средства и опытные мастера. Скидки первым клиентам! Детали ждут вас! Жмите https://himchistka-divanov-spb24.ru
Мобильная чистка в СПб и области вокруг! Мягкая мебель, ковры, кресла – возродим красоту и свежести прямо у вас дома! Звоните! Выбирайте https://himchistka-spb24.ru/
tadnx9
Двигайтесь к https://himchistka-divanov-msk24.ru/
Переходите Химчистка мебели петербург
Нажимайте Химчистка кожаной мебели на дому
Тапайте https://himchistka-msk24.ru/
Блеск и порядок в бизнесе в Питере! Чистота – залог продуктивной работы! Экспертный клининг. Привлекательные цены. Набирайте наш номер! Перемещайтесь к https://uborka-ofisov24spb.ru – уборка офиса фирмы
Чистый дом – счастливый дом! в Санкт-Петербурге и ЛО! Профессиональный клининг для вашего комфорта. Сохраним свежесть и порядок. Не откладывайте! Заходите https://uborka-domov24spb.ru – Клининговые услуги петербург
Уборка после ремонта? Забудьте о строительной пыли! Идеальный порядок квартир и домов. Быстро, тщательно, надежно! Кликайте https://klining-posle-remonta24spb.ru
Двигайтесь к https://uslugi-cleaninga.ru/
Перемещайтесь к СПб клининг
Кликайте https://clean-help24.ru/
Двигайтесь к https://chistka-mebel24spb.ru – Химчистка матраса
Жмите https://uslugi-uborki-spb24.ru – Мытье окон
Двигайтесь к https://himchistka-spb24speed.ru – Чистка диванов СПб на дому
Выбирайте https://kliningovaya-uborka-spb.ru – Уборка кухни
Пятна на любимой мебели? Освежим ей прежний вид! Чистка диванов, уютных кресел, пушистых покрытий в столице. Нажимайте https://himchistka-divanov-msk24.ru/
Очистка в Питере! Комнаты, Загородные резиденции, Рабочие помещения. Опытный уход по выгодным расценкам. Время для семьи и развлечений! Позвоните нам приборку в этот день! Двигайтесь к https://uborka-top24.ru – Заказ уборки на дом
Нажимайте https://uborka-v-spv24pro.ru
Клининг апартаментов в СПб! Свободное время для вас, а не на уборку! Профессиональный клининг. Стоимость от 1590 руб.. Закажите сейчас! Выбирайте https://uborka-kvartir24top.ru/
pharmacie en ligne france fiable: Kamagra oral jelly pas cher – kamagra gel
pilule bleu en pharmacie sans ordonnance: Pharmacie Express Рducray ictyane cr̬me ̩molliente visage et corps
comprar penicilina sin receta: Confia Pharma – curso online farmacia
farmacia oviedo online: comprar cialis sin receta en espa̱a Рpuedo comprar diazepam sin receta medica
comprar tardyferon sin receta: Confia Pharma Рcomprar priligy sin receta en espa̱a
ketoderm sans ordonnance en pharmacie: collier cervical pharmacie sans ordonnance Рcr̬me rap
testost̩rone pharmacie sans ordonnance: pernazene sans ordonnance Рerylik gel
https://confiapharma.shop/# se puede comprar ibuprofeno generico sin receta
avene cleanance creme lavante sildГ©nafil (50 mg boГ®te de 24) prix vomitif pharmacie sans ordonnance
medicament testosterone sans ordonnance en pharmacie: ordonnance fosfomycine – peroxyde de benzoyle pharmacie sans ordonnance
qlaira farmacia online: Confia Pharma – farmacia portuguesas online
xultophy prezzo: breva principio attivo – migliore farmacia omeopatica online
donde comprar mounjaro sin receta se puede comprar melatonina sin receta mi otra farmacia online
comprar sentis sin receta: loniten sin receta comprar – comprar dacortin sin receta
daflon sans ordonnance en pharmacie: ordonnance sГ©curisГ©e liste – ducray shampooing kelual ds
https://confiapharma.com/# se puede comprar levitra sin receta en farmacias fГsicas
eutirox 75 prezzo senza ricetta: dibase 25.000 flaconcini – samyr 400 fiale prezzo
farmacia online lasix farmacia online tudela puedo comprar las pastillas para dejar de fumar sin receta
comprar doxiciclina sin receta: Confia Pharma – comprar farmacia online barata
di base 25000: Farmacia Subito – tredimin 25.000 flaconcini
online farmacia europa augmentin bustine adulti prezzo miglior farmacia online 2022
fluimucil 300 mg per aerosol prezzo: Farmacia Subito – gonal f 900
que medicamentos se pueden comprar sin receta en canadГЎ: viagra online farmacia – farmacia online mas barato
rhumatologue ordonnance betamethasone sans ordonnance viagra tarif
http://pharmacieexpress.com/# ou acheter du viagra en pharmacie sans ordonnance
dermablend fond de teint: spedra sans ordonnance – ivermectine ordonnance
gelГ©e ultra fresh jouvence: Pharmacie Express – ordonnance pillule en ligne
pilule ordonnance obligatoire dentifrice sans fluor pharmacie trГ©tinoГЇne crГЁme pharmacie sans ordonnance
methotrexate prices pharmacy: online pharmacy furosemide – how much is adipex at the pharmacy
https://pharmexpress24.com/# lasix mexican pharmacy
pharmacy chains in india: indian pharmacies – compounding pharmacy in india
https://pharmexpress24.shop/# online pharmacy no scripts
history of pharmacy in india InPharm24 reliable pharmacy india
india online pharmacy: medicine online purchase – india e-pharmacy market size 2025
pharmacy direct viagra Pharm Express 24 Enalapril
https://pharmmex.shop/# is ozempic otc in mexico
Finax: celexa online pharmacy – ivermectin pharmacy uk
get medicines from india online medicine in india india online pharmacy
tamiflu pharmacy: Pharm Express 24 – prime rx pharmacy
mexican pharmacy weight loss: mexican pharmacy los angeles – mexican pharmacy pomona
india meds buy online medicine drugs from india
https://pharmexpress24.com/# european pharmacy viagra
meds from india: online pharmacy india – all day pharmacy india
online pharmacy cost: Pharm Mex – pharmacy in tijuana
generic cialis india pharmacy reliable pharmacy india buy medicines online india
online steroid pharmacy legit: mexican pharmacy tadalafil – percocet mexico
buy meds: glp 1 mexican pharmacy – apoquel in mexico
kroger pharmacy near me pharmacy cialis generic cheap medications
https://pharmmex.com/# best shipping meds
no prescription pharmacy valtrex: target pharmacy viagra – compare pharmacy prices
ozempic precio en tijuana: Pharm Mex – what to buy at mexican pharmacy
can you get hydrocodone in mexico: can you buy antibiotics over the counter in mexico – apteka usa online
pharmacy in india online: india mail order pharmacy – pharmacy from india
e pharmacy in india: online medical store india – buy medication from india
mexican pharmacy wegovy mexican percocet adderall in mexico otc
Cipro: sams club pharmacy propecia – bradleys pharmacy artane
https://inpharm24.com/# best online pharmacy india
value rx pharmacy tazewell tn: Pharm Express 24 – precision rx specialty pharmacy
pharmacies in india: drugs from india – online medical store india
viagra in hong kong pharmacy Pharm Express 24 how to buy viagra in pharmacy
mexican tramadol: ozempic buy in mexico – wegovy mexican pharmacy
elocon cream boots pharmacy Pharm Express 24 wal mart pharmacy prices cialis
online pharmacy percocet 30 mg: online pharmacy cellcept – pharmacy program online
https://pharmexpress24.shop/# provigil online pharmacy
pharmacy india medical store online pharmacy council of india
buy medicines online india: pharmacy store in india – india e-pharmacy market size 2025
india online pharmacy: india pharmacy delivery – first online pharmacy in india
fear pharmacy ativan Pharm Express 24 tesco pharmacy cialis
india online pharmacy store: hepatitis c virus (hcv) – nexium indian pharmacy
sildenafil 25 mg: viagra price mexico – female viagra australia for sale
generic viagra online united states: VGR Sources – best price viagra uk
cheap real viagra online: viagra mexico – sildenafil 20 mg cost
viagra rx online VGR Sources generic viagra cost canada
best price for genuine viagra: VGR Sources – viagra pharmacy cost
buy real viagra from canada: viagra chewable – where to buy viagra online uk
https://vgrsources.com/# cost of viagra in usa
how much is a 100mg viagra: VGR Sources – buy viagra online united states
sildenafil 25 mg price in india VGR Sources viagra without prescription in united states
sildenafil tablets 150mg: buying viagra online illegal – sildenafil 100mg australia
viagra pharmacy india: viagra 120 mg – viagra prices singapore
sildenafil chewable tablets: buy viagra in usa – viagra side effects
buy female viagra uk VGR Sources generic viagra price canada
order viagra on line: real viagra pills online – online pharmacy australia viagra
https://vgrsources.com/# generic sildenafil no prescription
best prices for viagra in canada: best viagra online australia – viagra cost in australia
buy generic viagra 100mg: VGR Sources – viagra generic over the counter
how to purchase viagra pills VGR Sources generic viagra online
order sildenafil 20 mg: female viagra sildenafil – how can i get viagra
sildenafil otc uk: buy viagra cheap australia – viagra 130 mg
sildenafil 58: sildenafil nz cost – sildenafil 25mg 50mg 100mg
buy generic sildenafil online VGR Sources generic viagra india 100mg
viagra prescription cost uk: sildenafil tablets 50mg – sildenafil generic over the counter
https://vgrsources.com/# how much is viagra online
where can i buy cheap viagra in australia: wholesale viagra – can you purchase viagra over the counter
preГ§o viagra 50mg: VGR Sources – viagra 100 mg generic
usa viagra over the counter female viagra buy female viagra united states
how can i get generic viagra in canada: viagra script online – 40 mg sildenafil
where to buy generic viagra online in canada: VGR Sources – viagra tablets for men
viagra for sale canada: VGR Sources – viagra mexico over the counter
usa viagra online sildenafil tab 50mg cost purchase viagra india
viagra 250 mg: how to safely order viagra online – viagra generic online cheapest
https://vgrsources.com/# best viagra pills over the counter
price generic sildenafil: VGR Sources – female viagra price in india
sildenafil brand name india: VGR Sources – generic viagra online us pharmacy
viagra singapore price VGR Sources where to buy generic viagra in canada
generic sildenafil usa: sildenafil purchase india – how can i get a prescription for viagra
viagra prescription drugs: VGR Sources – viagra 5mg price
viagra super active plus: cheap sildenafil 100 – sildenafil online united states
cost of viagra 100mg tablet order viagra uk buy viagra 100mg uk
where can you get women’s viagra: VGR Sources – can you order viagra without a prescription
buy viagra 100 mg online: where to buy viagra online without prescription – buy generic viagra online cheap
https://vgrsources.com/# order viagra online canadian pharmacy
buy online viagra tablets: female viagra online india – 1 viagra
sildenafil citrate over the counter VGR Sources viagra online order in india
sildenafil 100mg tablets price: VGR Sources – buy viagra cheap
viagra usa over the counter: viagra for women australia – sildenafil 120 mg
where can i get over the counter viagra: VGR Sources – where to buy cheap viagra online
purchasing viagra VGR Sources viagra over the counter uk
sildenafil 30 mg: VGR Sources – viagra tablets australia
female viagra where to buy: VGR Sources – buy viagra pills canada
https://vgrsources.com/# woman viagra
buy viagra canadian pharmacy: viagra cost in uk – buy viagra online australia fast delivery
viagra 100mg price india VGR Sources sildenafil tablets coupon
200 mg sildenafil: sildenafil tablets for sale – cheap rx sildenafil
online viagra prescription: viagra 100mg tablet online in india – cheap canadian viagra pharmacy
sildenafil 48 tabs 50 mg price: VGR Sources – sildenafil pharmacy uk
cheap viagra online usa where to get generic viagra sildenafil 105 mg canada
sildenafil 50mg uk: canadian pharmacy viagra no prescription – viagra pills price in usa
where can i buy viagra with paypal: can i purchase viagra over the counter in canada – how to buy viagra in usa
https://vgrsources.com/# generic sildenafil us
Wo kann ich generisches Viagra online bestellen?: purchasing viagra in mexico – 150 mg viagra
viagra pill VGR Sources viagra free shipping canada
price for sildenafil 100 mg: how to buy viagra from canada – cheap sildenafil online no prescription
CrestorPharm: Generic Crestor for high cholesterol – Crestor Pharm
LipiPharm: Safe atorvastatin purchase without RX – crestor to lipitor conversion
CrestorPharm: Crestor Pharm – Safe online pharmacy for Crestor
SemagluPharm SemagluPharm SemagluPharm
http://crestorpharm.com/# CrestorPharm
can crestor cause nightmares: Crestor Pharm – Safe online pharmacy for Crestor
prednisone 10 mg tablet cost: prednisone 5 tablets – PredniPharm
SemagluPharm: rybelsus tablet – Semaglu Pharm
PredniPharm Predni Pharm can i buy prednisone online without prescription
CrestorPharm: Crestor Pharm – rosuvastatin recall 2024
Semaglu Pharm: Safe delivery in the US – FDA-approved Rybelsus alternative
Semaglu Pharm: Semaglu Pharm – SemagluPharm
prednisone 40 mg tablet prednisone acetate prednisone 54
https://crestorpharm.shop/# Generic Crestor for high cholesterol
Buy statins online discreet shipping: Crestor Pharm – Crestor Pharm
Crestor Pharm: can you cut rosuvastatin pills in half – Crestor Pharm
Predni Pharm Predni Pharm prednisone 300mg
Affordable cholesterol-lowering pills: Over-the-counter Crestor USA – milk thistle and rosuvastatin
Safe online pharmacy for Crestor: Crestor Pharm – CrestorPharm
https://crestorpharm.shop/# can i cut rosuvastatin in half
LipiPharm atorvastatin substitute LipiPharm
atorvastatin vs lovastatin: LipiPharm – LipiPharm
Lipi Pharm: Affordable Lipitor alternatives USA – LipiPharm
Semaglu Pharm: Semaglutide tablets without prescription – Order Rybelsus discreetly
Semaglu Pharm can semaglutide cause diarrhea Semaglu Pharm
Rybelsus online pharmacy reviews: traveling with semaglutide – SemagluPharm
CrestorPharm: Buy cholesterol medicine online cheap – Rosuvastatin tablets without doctor approval
http://crestorpharm.com/# ezetimibe/rosuvastatin
Order cholesterol medication online lipitor use what not to take with atorvastatin
Lipi Pharm: Lipi Pharm – Lipi Pharm
Crestor Pharm: Crestor Pharm – crestor drug
PredniPharm where can i buy prednisone without a prescription prednisone 40mg
SemagluPharm: Where to buy Semaglutide legally – SemagluPharm
cheapest prednisone no prescription: Predni Pharm – PredniPharm
atorvastatin complications: difference between atorvastatin and rosuvastatin – adverse effects of atorvastatin
Crestor Pharm CrestorPharm CrestorPharm
https://lipipharm.com/# can you drink on lipitor
Semaglu Pharm: does semaglutide make you depressed – Where to buy Semaglutide legally
prednisone 5 mg tablet price compare prednisone prices PredniPharm
Crestor Pharm: Crestor Pharm – CrestorPharm
crestor to lipitor: why do you take rosuvastatin at night – Buy statins online discreet shipping
LipiPharm Lipi Pharm Lipi Pharm
https://prednipharm.com/# prednisone for sale in canada
prednisone cost us: PredniPharm – prednisone 5 mg
should i take crestor in the morning or at night: CrestorPharm – CrestorPharm
diabetes medication rybelsus SemagluPharm zepbound vs semaglutide
lipitor adverse effects: Affordable Lipitor alternatives USA – Lipi Pharm
п»їBuy Rybelsus online USA: semaglutide cyanocobalamin – semaglutide side effects cancer
rosuvastatin missed dose side effects: rosuvastatin calcium brand name – crestor once a week
CrestorPharm: does crestor cause kidney damage – CrestorPharm
Crestor Pharm CrestorPharm CrestorPharm
http://lipipharm.com/# Lipi Pharm
prednisone canada prices: Predni Pharm – Predni Pharm
atorvastatin and dizziness LipiPharm LipiPharm
Atorvastatin online pharmacy: LipiPharm – п»їBuy Lipitor without prescription USA
can i order prednisone: PredniPharm – Predni Pharm
Lipi Pharm FDA-approved generic statins online Lipi Pharm
Semaglu Pharm: Safe delivery in the US – No prescription diabetes meds online
https://prednipharm.com/# Predni Pharm
Order cholesterol medication online: Lipi Pharm – Cheap Lipitor 10mg / 20mg / 40mg
crestor vs zetia Order rosuvastatin online legally CrestorPharm
LipiPharm: Atorvastatin online pharmacy – LipiPharm
prednisone online sale: Predni Pharm – buy prednisone without prescription paypal
No prescription diabetes meds online: п»їBuy Rybelsus online USA – Order Rybelsus discreetly
what are the long term side effects of lipitor: LipiPharm – LipiPharm
https://lipipharm.com/# Lipi Pharm
Predni Pharm ordering prednisone PredniPharm
SemagluPharm: does semaglutide lower blood pressure – manufacturer coupon for rybelsus
what is the highest dose of semaglutide for weight loss: is tirzepatide the same as semaglutide – Semaglu Pharm
how much does rybelsus cost with insurance get rybelsus prescription online Rybelsus side effects and dosage
prednisone 20mg by mail order: PredniPharm – prednisone 12 mg
Predni Pharm: PredniPharm – Predni Pharm
https://semaglupharm.com/# Semaglu Pharm
side effects of crestor 20 mg Best price for Crestor online USA does rosuvastatin raise blood pressure
Crestor Pharm: Crestor Pharm – what is rosuvastatin generic for
CrestorPharm: Crestor Pharm – Crestor Pharm
LipiPharm LipiPharm Online statin drugs no doctor visit