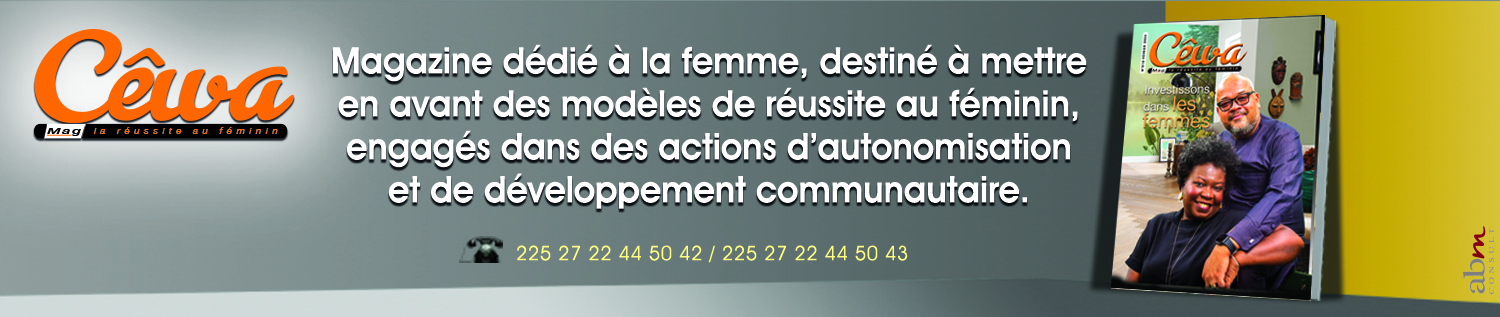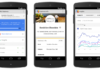C’est un tournant historique pour la sous-région d’Afrique centrale. Le 19 mai 2025, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu la souveraineté de la Guinée équatoriale sur trois îlots stratégiques situés dans la baie de Corisco, mettant ainsi fin à un litige vieux de plus d’un demi-siècle avec le Gabon. En jeu : quelques kilomètres carrés en mer, mais surtout, un vaste potentiel pétrolier et gazier.
Trois îles, de grands enjeux
Mbanié, Cocotiers et Conga : trois petits noms qui cachent d’immenses enjeux géopolitiques et économiques. Ces îles, posées entre la côte gabonaise et l’île équato-guinéenne de Corisco, semblaient anodines sur la carte. Pourtant, elles se trouvent dans une zone maritime aux ressources énergétiques prometteuses, dans l’un des golfes les plus convoités du continent africain.
Contrôler ces îles, c’est revendiquer un droit souverain sur plusieurs centaines de kilomètres carrés de zone économique exclusive (ZEE), avec à la clé, l’exploitation possible de gisements d’hydrocarbures offshore.
Une décision fondée sur l’histoire coloniale
Le différend prend racine dans les flous de la colonisation. Le Gabon, ancienne colonie française, et la Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole, se disputaient depuis des décennies la paternité de ces îles, sans jamais avoir formellement fixé leurs frontières maritimes.
En s’appuyant sur la convention franco-espagnole de 1900, la CIJ a conclu que la souveraineté revenait à l’Espagne, et par succession, à la Guinée équatoriale. La Cour a rejeté les arguments gabonais fondés sur une soi-disant « convention de Bata » signée en 1974, faute de preuve formelle de son existence ou de sa validité juridique.
Une victoire diplomatique pour Malabo
Ce verdict renforce la position diplomatique de la Guinée équatoriale dans la région. Surtout, il oblige le Gabon à retirer ses troupes de l’île de Mbanié, qu’il occupait depuis 1972. Une présence contestée, mais tolérée par un statu quo fragile, en attendant l’arbitrage international désormais définitif.
C’est aussi une rare démonstration de résolution pacifique de différends en Afrique, les deux pays ayant volontairement saisi la CIJ en 2016, sous l’égide des Nations Unies. Une approche saluée par de nombreux observateurs du droit international et des relations interafricaines.
Des retombées économiques à surveiller
La décision relance les perspectives économiques pour Malabo. Si des hydrocarbures sont effectivement découverts ou valorisés dans la zone, la Guinée équatoriale pourrait voir ses recettes d’exportation renforcées, dans un contexte où le pays cherche à stabiliser son économie post-pétrole.
Pour le Gabon, en revanche, c’est un revers stratégique. Le pays devra revoir ses ambitions maritimes dans le nord-ouest et potentiellement renégocier ses zones d’exploration avec les compagnies pétrolières présentes dans la région.
Un précédent pour l’Afrique ?
Au-delà du cas précis, ce jugement pourrait faire école. L’Afrique, où nombre de frontières terrestres et maritimes sont encore contestées, pourrait s’inspirer de ce processus pour régler d’autres contentieux similaires – du lac Tchad à la mer Rouge.
Dans ce sens, la CIJ ne s’est pas seulement prononcée sur trois îles. Elle a aussi rappelé que la stabilité régionale passe par le respect du droit, et que le dialogue vaut mieux que les armes.