Les relations entre les États-Unis et l’Afrique du Sud traversent une zone de turbulences alimentée… par une théorie du complot. En amont de la visite de Cyril Ramaphosa à Washington, Axios révèle que la vision de Donald Trump sur le pays repose en partie sur la croyance – infondée – en un « génocide blanc » visant les fermiers sud-africains.
Une visite sous haute tension
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’apprête à rencontrer Donald Trump dans un climat diplomatique particulièrement tendu. À l’agenda officiel : une « réinitialisation stratégique » des relations bilatérales. Mais en coulisses, c’est une défiance grandissante qui s’installe entre Pretoria et Washington. L’administration Trump a récemment coupé toute aide étrangère à l’Afrique du Sud et suspendu sa coopération sur le prochain sommet du G20, prévu à Johannesburg.
Signe du malaise : Elon Musk, né en Afrique du Sud et aujourd’hui proche de Trump, participera aux discussions. Le milliardaire a lui-même alimenté les discours complotistes sur un supposé « génocide blanc » dans son pays d’origine.
Le spectre d’un complot raciste
À l’origine de ces tensions, une idée fausse mais tenace : les fermiers blancs, principalement afrikaners, seraient aujourd’hui persécutés et tués en Afrique du Sud. Une accusation que Donald Trump a relayée à plusieurs reprises, allant jusqu’à accorder le statut de réfugiés à certains Sud-Africains blancs, tout en fermant la porte à d’autres demandeurs d’asile, notamment venus d’Amérique latine.
En cause, la réforme agraire menée par Pretoria, qui autorise l’expropriation sans compensation de certaines terres agricoles. L’objectif : corriger les déséquilibres fonciers hérités de l’apartheid, qui a privé pendant des décennies la majorité noire sud-africaine de droits de propriété. Aujourd’hui encore, les Blancs – qui ne représentent que 7% de la population – détiennent 72% des terres agricoles. Une injustice historique que le gouvernement tente de corriger.
Mais dans la rhétorique trumpienne, cette politique se transforme en persécution. Le président américain dénonce une expropriation « injuste » des propriétés blanches et accuse le pouvoir sud-africain de fermer les yeux sur une prétendue vague de violences ciblées.
Aucun fondement dans les faits
Pourtant, aucun chiffre sérieux ne confirme une hausse spécifique de violences contre les fermiers blancs. Les meurtres agricoles touchent toutes les communautés. La justice sud-africaine elle-même a qualifié de « fictives » les accusations de génocide. Et le principal parti d’opposition blanc, l’Alliance Démocratique, conteste la réforme foncière tout en rejetant l’idée d’un complot racial.
Derrière cette narration se cache une idéologie dangereuse : celle de la « théorie du grand remplacement » – selon laquelle les populations blanches seraient progressivement éliminées ou marginalisées à travers des politiques délibérées. Longtemps cantonnée aux cercles d’extrême droite, cette croyance s’est infiltrée au plus haut niveau de la politique américaine.
Une fracture stratégique
En privilégiant les Sud-Africains blancs comme réfugiés, l’administration Trump ne se contente pas d’appliquer une politique d’immigration sélective : elle envoie un signal politique fort, teinté d’idéologie. Cette posture rompt avec la tradition diplomatique américaine d’impartialité dans les affaires internes des pays partenaires.
Le rejet affiché de la conférence du G20 prévue à Johannesburg, tout comme les déclarations de figures politiques américaines comme le sénateur Marco Rubio, qui accuse Pretoria d’atteintes à la propriété privée, ne sont pas sans conséquences. Elles alimentent l’idée d’un affrontement de valeurs entre un Sud global en quête de réparation historique, et une droite populiste occidentale nostalgique d’un certain ordre racial.
Un test pour l’Afrique du Sud, un miroir pour l’Amérique
Pour l’Afrique du Sud, cette polémique est un test : celui de sa capacité à mener une politique de justice sociale sans être affaiblie par la désinformation et les pressions extérieures. Pour les États-Unis, c’est un miroir tendu vers leurs propres fractures idéologiques, où la réalité cède parfois le pas à des récits identitaires instrumentalisés.
La rencontre Ramaphosa-Trump, censée rapprocher deux partenaires stratégiques, illustre au contraire la manière dont les théories du complot, lorsqu’elles sont reprises au sommet de l’État, peuvent altérer la diplomatie et brouiller les priorités internationales. Derrière les postures, c’est toute la cohérence des alliances globales qui est en jeu.

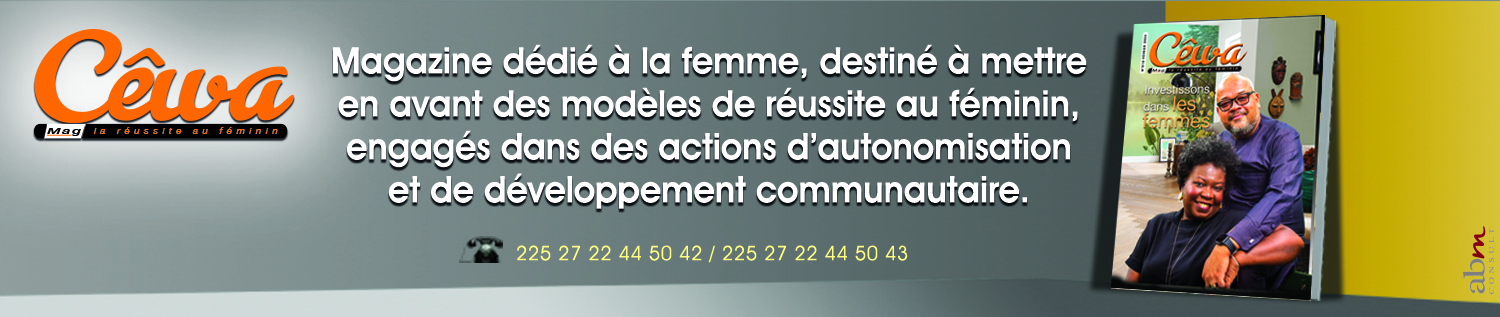






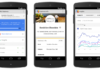




where to buy cheap clomiphene price can i buy cheap clomid price get generic clomiphene for sale cost clomid for sale get cheap clomiphene pills clomid costo how to get generic clomiphene tablets
The vividness in this ruined is exceptional.
This is the description of content I enjoy reading.
buy azithromycin for sale – buy generic tinidazole online where can i buy metronidazole
rybelsus 14mg for sale – order rybelsus pill buy cyproheptadine paypal
buy domperidone generic – domperidone 10mg generic oral cyclobenzaprine
buy inderal 20mg pills – order clopidogrel 150mg pills methotrexate canada
purchase amoxil generic – buy generic amoxil cheap ipratropium
order zithromax 250mg pills – buy azithromycin 500mg for sale brand nebivolol 5mg
buy augmentin sale – https://atbioinfo.com/ order ampicillin generic
buy nexium 40mg sale – https://anexamate.com/ order generic esomeprazole 40mg
buy warfarin online – https://coumamide.com/ losartan order
buy meloxicam medication – mobo sin buy mobic paypal
prednisone 10mg price – https://apreplson.com/ cost prednisone 40mg
best pills for ed – ed pills where to buy erection problems
order amoxil without prescription – cost amoxicillin how to buy amoxicillin