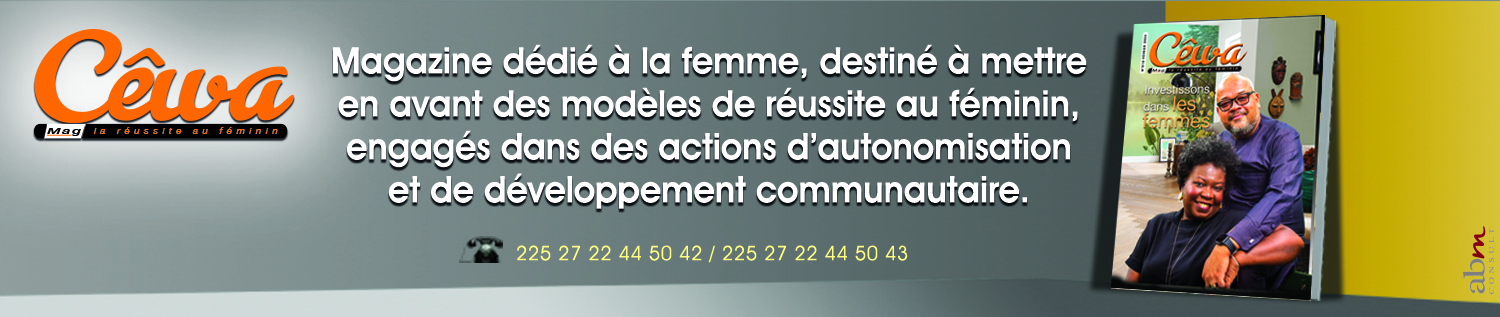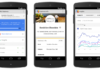Le Niger a franchi une étape majeure dans sa lutte contre la désertification. Hier, jeudi 3 juillet, le gouvernement nigérien et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont signé un accord de financement de 17 milliards FCFA (32 millions de dollars) pour le projet SURAGGWA. Ce programme ambitieux vise à restaurer 265 000 hectares de terres dégradées et à renforcer la résilience des communautés agropastorales. Mais que signifie cet accord pour le Niger et le Sahel ?
Une réponse aux défis climatiques
Le Sahel, vaste région aride s’étendant de l’Atlantique à la mer Rouge, fait face à des défis colossaux. Désertification, sécheresses récurrentes et insécurité alimentaire menacent des millions de vies. Au Niger, où 80% de la population dépend de l’agriculture et de l’élevage, ces crises sont particulièrement aiguës. L’Initiative de la Grande Muraille Verte, lancée en 2007 par l’Union Africaine, ambitionne de transformer cette région en restaurant 100 millions d’hectares de terres d’ici 2030.
Le projet SURAGGWA (Scaling-Up Resilience in Africa’s Great Green Wall) s’inscrit dans cette vision. Financé à hauteur de 222 millions de dollars pour huit pays sahéliens, dont 150 millions du Fonds Vert pour le Climat, il mobilise des ressources pour reverdir les terres et créer des opportunités économiques. Le Niger, membre clé de l’initiative, bénéficie de cet accord pour accélérer ses efforts.
Un projet aux multiples visages
Signé à Niamey le 3 juillet 2025, l’accord engage le Niger et la FAO dans un partenariat de dix ans. « Ce que nous célébrons aujourd’hui n’est pas seulement un accord administratif. C’est une promesse faite à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à nos jeunes et à nos femmes rurales », a déclaré Alio Daouda, ministre nigérien de la Justice, signataire pour le gouvernement.
Concrètement, le projet vise à restaurer 265 000 hectares de terres dégradées. Des techniques comme les fosses zai (petits bassins retenant l’eau) et les demi-lunes seront utilisées pour capter les pluies et revitaliser les sols. Environ 700 pépinières communautaires seront créées pour produire des plants d’arbres. Ces initiatives s’appuieront sur la régénération naturelle assistée, une méthode qui protège la végétation existante.
Le projet ne se limite pas à l’environnement. Il prévoit de former 1 000 groupes communautaires, avec un accent sur les jeunes et les femmes, pour gérer durablement les ressources. Il ambitionne aussi de créer 1 000 emplois durables, renforçant ainsi les moyens de subsistance. « La FAO va continuer à soutenir le Niger dans ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle », a assuré Luc Genot, représentant par intérim de la FAO au Niger.
Des impacts économiques et sociaux
L’accord économique de SURAGGWA est significatif. En restaurant les terres, le projet augmentera la productivité agricole, essentielle pour un pays où la malnutrition touche 20% des enfants. La création d’emplois et le développement de chaînes de valeur, comme les produits forestiers non ligneux (fourrages, gommes), stimuleront l’économie rurale. Les femmes, souvent marginalisées, bénéficieront d’un accès accru aux opportunités économiques.
Sur le plan environnemental, la séquestration de carbone contribuera à réduire les émissions de CO₂, alignant le projet avec les objectifs climatiques mondiaux. Ces efforts renforceront la résilience des communautés face aux sécheresses et aux crises économiques.
Un symbole d’espoir pour le Sahel
L’accord Nigero-FAO est une lueur d’espoir pour le Sahel. Il illustre une collaboration réussie entre un gouvernement national, la FAO et des partenaires comme l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cependant, les défis restent immenses : la coordination régionale, la gouvernance et le suivi des fonds seront cruciaux pour garantir le succès du projet.
Le Niger, qui abrite déjà des projets pilotes comme celui de la région de Zinder, montre l’exemple. Avec SURAGGWA, le pays pourrait devenir un modèle pour les autres nations sahéliennes. D’ici 2035, les résultats pourraient transformer non seulement les paysages, mais aussi les perspectives d’avenir pour des millions de Nigériens.