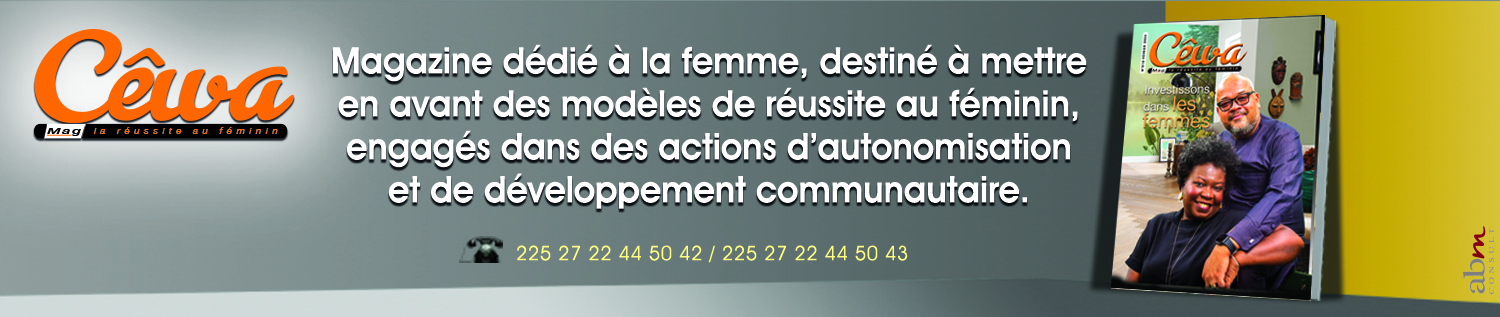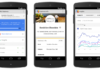Washington envisage-t-il de faire ses valises dans plusieurs capitales africaines ? Une fuite relayée par le New York Times en avril 2025 laisse entrevoir une possible fermeture de six ambassades américaines sur le continent. Une perspective qui, au-delà de la simple réorganisation administrative, soulève de profondes inquiétudes.
Selon un document interne du Département d’État, les représentations diplomatiques en Gambie, Érythrée, République centrafricaine, Lesotho, République du Congo et Soudan du Sud seraient sur la sellette. Pour beaucoup, cette mesure, si elle se confirme, marquerait une rupture nette dans la politique africaine des États-Unis.
Le cœur du problème ? L’argent. L’administration Trump, dans une logique de rigueur budgétaire, cherche à réduire drastiquement les dépenses fédérales. Le budget du Département d’État pourrait ainsi passer de 54,4 milliards de dollars en 2025 à seulement 28,4 milliards l’année suivante. Dans ce contexte, les ambassades, souvent coûteuses à entretenir, deviennent une cible facile.
Mais derrière ces chiffres se cachent des visages, des histoires, des relations construites sur des années. Car une ambassade, ce n’est pas qu’un bâtiment officiel. C’est un lien vivant entre deux nations. C’est là que se tissent les partenariats économiques, que se sécurisent les investissements et que se promeut la culture américaine. En 2023, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Afrique subsaharienne représentaient tout de même 44 milliards de dollars. Saborder ces points d’ancrage reviendrait à fragiliser ces liens.
Ce projet intervient à un moment délicat. La Chine et la Russie, elles, accélèrent leur ancrage diplomatique sur le continent. Pékin étend son réseau d’ambassades, finance des infrastructures via son initiative « Belt and Road », pendant que Moscou renforce ses accords militaires. Si Washington se retire, la place ne restera pas vide bien longtemps.
Pour l’instant, rien n’est gravé dans le marbre. Le Congrès doit encore se prononcer sur le budget 2026. Et si certains élus républicains applaudissent cette logique d’austérité, d’autres s’inquiètent de l’affaiblissement de l’influence américaine à l’étranger. Le Département d’État, lui, reste silencieux. Quant aux pays concernés, ils n’ont reçu aucune notification officielle. Une incertitude qui alimente les spéculations dans les chancelleries africaines.
Sur le terrain, les conséquences seraient bien réelles. Outre les services consulaires, les ambassades emploient du personnel local et soutiennent souvent des projets humanitaires. En République centrafricaine, par exemple, les États-Unis financent des programmes vitaux contre la faim. Fermer l’ambassade, ce serait aussi couper ces soutiens.
Ce projet reflète un pari risqué : celui de privilégier les économies à court terme au détriment de l’influence à long terme. Car l’Afrique, avec sa croissance, son dynamisme et ses ressources stratégiques, est au cœur des convoitises mondiales. S’en désengager serait laisser le champ libre aux autres puissances.
Les semaines à venir seront décisives. Le Congrès tranchera. En attendant, les capitales africaines retiennent leur souffle. Une chose est sûre : derrière les calculs comptables, se joue une question essentielle pour l’Amérique – veut-elle encore peser sur l’avenir du continent africain ?