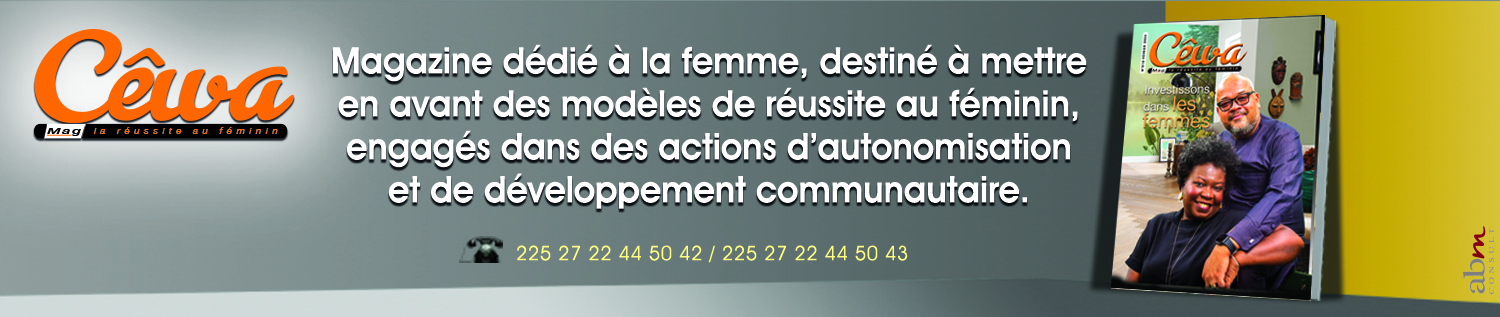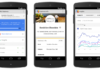La République démocratique du Congo (RDC) joue une carte audacieuse. Elle offre aux États-Unis un accès exclusif à ses minerais stratégiques – cobalt, lithium, tantale, uranium – pour écraser une rébellion soutenue par le Rwanda dans l’est du pays. Révélée par Bloomberg le 5 mars 2025, cette proposition fait écho à une tentative avortée de l’Ukraine. Deux nations en péril, un même calcul : leurs richesses contre un sauvetage américain.
La RDC n’est pas un petit joueur. Elle fournit 60% du cobalt mondial, vital pour les batteries des voitures électriques. Ses sols regorgent aussi de cuivre, de lithium et d’uranium, des trésors pour la tech et la défense. Mais l’est du pays, où ces mines prospèrent, est un champ de bataille. Le président Félix Tshisekedi propose un deal : droits d’extraction pour les firmes américaines et un rôle dans un futur port atlantique. En échange, il réclame armes, entraînements et troupes pour contrer les rebelles.
Bloomberg cite un lobby afro-américain plaidant pour Kinshasa : « Les ressources de la RDC sont essentielles à la compétitivité industrielle et à la sécurité nationale des États-Unis. » L’objectif est clair : séduire Donald Trump. Washington y voit une aubaine pour briser la mainmise chinoise, qui contrôle 70% des mines congolaises via des géants comme China Molybdenum.
L’Ukraine a testé la même recette. Fin 2024, Kyiv a mis sur la table son titane – clé pour l’aérospatiale – et son lithium, contre un soutien financier pour rebâtir après la guerre contre la Russie. Les États-Unis ont réclamé un accès total aux réserves pour 500 milliards de dollars, une somme jugée exorbitante. L’accord a coulé la semaine dernière, Kyiv refusant de brader son avenir.
Une tendance se dessine. Les pays en crise, assis sur des minerais rares, frappent à la porte de Washington. Ces ressources alimentent les rêves d’énergie verte et d’armement high-tech de l’Occident. Mais les embûches s’accumulent. En RDC, la corruption gangrène le secteur minier : 2 milliards de dollars s’évaporent chaque année, selon l’ONG Global Witness. Les abus – travail d’enfants, rivières polluées – rebutent les investisseurs américains. En Ukraine, la peur de perdre sa souveraineté a torpillé les pourparlers.
Pour les États-Unis, le dilemme est réel. Dégager la Chine des chaînes d’approvisionnement est tentant. Trump, fan des deals directs, pourrait mordre. Mais s’engager militairement coûte cher : des milliards, voire des vies, dans des bourbiers lontains. Sous Biden, les entreprises ont snobé la RDC, échaudées par son chaos. Pourquoi cela changerait-il ?
La RDC et l’Ukraine jouent leur survie. Kinshasa veut sauver ses mines des rebelles. Kyiv veut des fonds pour ses ruines. Mais céder leurs joyaux les enchaînerait à Washington. Pendant ce temps, Pékin guette, prêt à exploiter tout faux pas américain pour raffermir son emprise.
Ces pactes redéfinissent les rapports de force. Ils exposent aussi une vérité crue : les nations riches en ressources restent des proies dans l’arène mondiale. Trump sautera-t-il dans la mêlée ? Rien n’est moins sûr. Mais une chose est claire : ces deals pourraient façonner l’économie de demain – ou s’effondrer comme des châteaux de cartes.