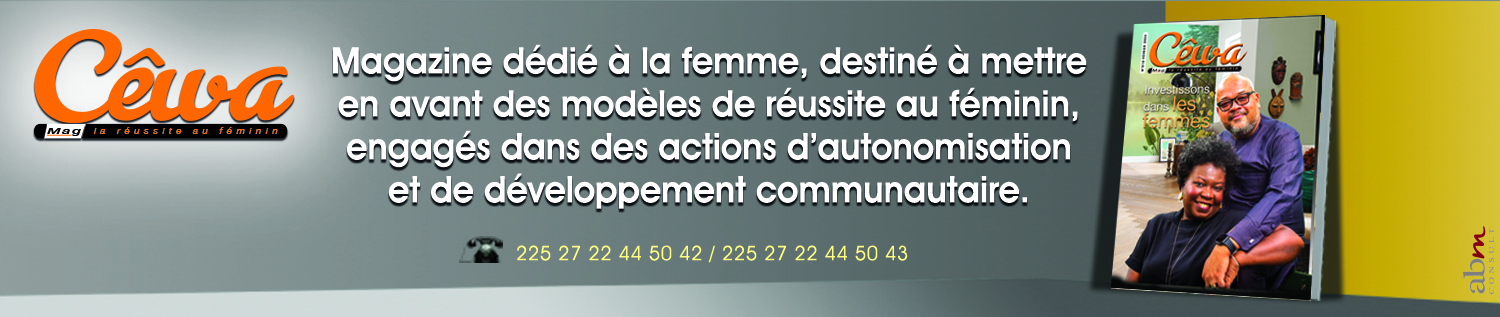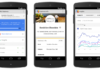Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), la guerre fait rage. Le Mouvement du 23 mars (M23), accusé par Kinshasa d’être soutenu par le Rwanda, contrôle des villes clés et des mines riches en cobalt et coltan. Ces minerais, essentiels aux batteries des voitures électriques et aux smartphones, sont au cœur d’une proposition audacieuse : la RDC offre aux États-Unis un accès privilégié à ses ressources en échange d’une aide militaire. Mais ce pari peut-il ramener la paix ?
Un conflit alimenté par les richesses du sol
L’est de la RDC est un paradoxe. Ses sols regorgent de cobalt (70% de la production mondiale), de lithium et de coltan, des minerais cruciaux pour la transition énergétique. Pourtant, cette richesse est une malédiction. Depuis trois décennies, des groupes armés pillent ces ressources, finançant leurs arsenaux grâce à la contrebande. Le M23, actif dans le Nord-Kivu, contrôle notamment la mine de Rubaya, d’où 120 tonnes de coltan partent chaque mois vers le Rwanda, selon des estimations. Kinshasa accuse Kigali de voler ses richesses, une allégation que le Rwanda rejette, affirmant exploiter ses propres gisements.
Ce conflit a un coût humain terrifiant. Plus de 7 millions de personnes sont déplacées. Les violences, incluant viols et enrôlements d’enfants, sont monnaie courante. Les minerais, surnommés “de sang”, sont le carburant de cette crise. Ils attirent aussi les regards des grandes puissances, avides de sécuriser leurs approvisionnements.
Une proposition stratégique aux États-Unis
Face à l’avancée du M23, la RDC cherche des alliés. Depuis février 2025, le président Félix Tshisekedi négocie avec Washington un accord audacieux : un accès exclusif aux minerais congolais contre une aide militaire. Cobalt, lithium, tantale, uranium… La liste des ressources proposées est alléchante pour les États-Unis, qui veulent réduire leur dépendance à la Chine, dominante dans l’exploitation minière congolaise.
L’offre inclut des projets ambitieux, comme un port en eau profonde sur l’Atlantique et un stock stratégique commun de minerais. En retour, Kinshasa demande des armes, des formations pour ses soldats et, peut-être, des bases américaines pour protéger les sites miniers. Ces discussions, encore exploratoires, ont pris de l’ampleur après la visite de l’émissaire américain Massad Boulos en avril 2025. Des entreprises américaines pourraient investir des milliards dans les infrastructures congolaises. Selon la presse locale, la RDC s’attend à des investissements de l’Oncle Sam estimés à près de 500 milliards de dollars sur une période de 15 ans.
Des efforts diplomatiques à Doha
Parallèlement, la communauté internationale s’active. Le 30 avril 2025, des représentants des États-Unis, de la France, du Qatar, du Togo, de la RDC et du Rwanda se sont réunis à Doha pour discuter de la paix. Cette rencontre, dans la lignée d’un sommet trilatéral en mars, a salué un cessez-le-feu fragile entre la RDC et le M23, facilité par le Qatar. Les discussions ont aussi porté sur la crise humanitaire et les causes profondes du conflit, comme l’exploitation illégale des minerais.
Ces efforts s’appuient sur des initiatives régionales. En février, un sommet à Dar es Salaam, réunissant la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), a posé des jalons. Une Déclaration de principes, signée à Washington le 25 avril, a renforcé l’élan. Mais la présence du Rwanda à la table des négociations reste controversée, tant les tensions avec la RDC sont vives.
Un pari risqué pour Kinshasa
La proposition de la RDC aux États-Unis est un pari stratégique. Un soutien américain pourrait freiner le M23 et sécuriser les mines. Mais les défis sont immenses. La corruption gangrène le secteur minier congolais. Les conditions de travail dans les mines sont souvent inhumaines, et l’impact environnemental est désastreux. Un afflux d’investissements étrangers, sans réformes, pourrait aggraver ces problèmes.
De plus, marginaliser le Rwanda pourrait attiser les tensions régionales. Kigali, qui nie tout soutien au M23, pourrait riposter économiquement ou diplomatiquement. La Chine, quant à elle, observe attentivement, peu encline à céder sa mainmise sur les minerais congolais.
Vers une paix durable ?
L’avenir de l’est de la RDC dépend de plusieurs facteurs. Un cessez-le-feu durable est urgent pour acheminer l’aide humanitaire. Mais sans s’attaquer à la contrebande des minerais, le conflit risque de perdurer. Les États-Unis, prudents, privilégient leurs intérêts économiques à un engagement militaire direct. La proposition de Kinshasa pourrait changer la donne, mais elle soulève une question : la paix peut-elle vraiment s’acheter avec des minerais ?
Pour l’heure, les Congolais de l’est continuent de payer le prix fort. Alors que les puissances se disputent leurs richesses, la région attend des solutions concrètes. Doha, Washington, Kinshasa : les négociations se multiplient. Reste à savoir si elles déboucheront sur une paix véritable ou sur un nouvel épisode de la course aux minerais.