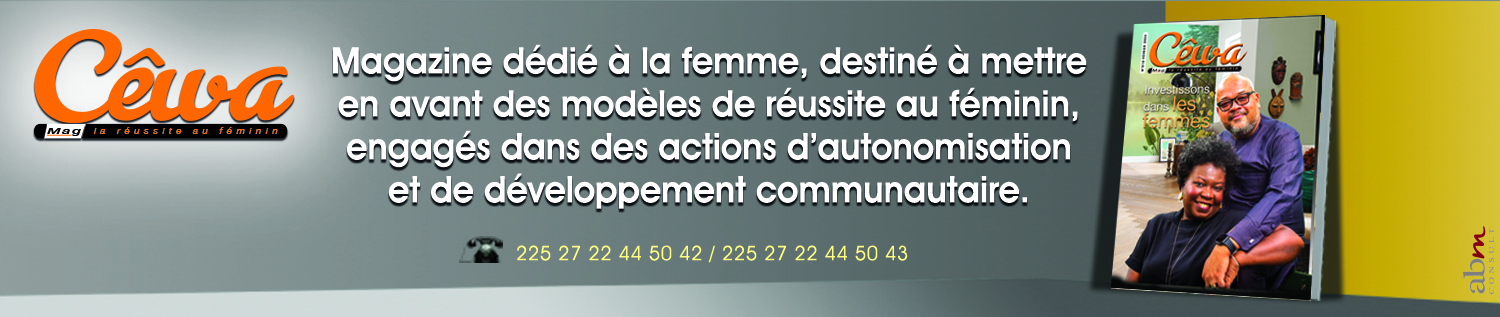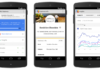Le 17 mai 2025, Orano, géant français de l’uranium, a annoncé explorer la vente de ses actifs au Niger. Cette décision marque un tournant dans un conflit qui oppose l’entreprise aux militaires au pouvoir. Elle pourrait bouleverser l’industrie mondiale de l’uranium.
Depuis des décennies, Orano, anciennement Areva, exploite l’uranium nigérien. Mais les relations avec Niamey se sont effondrées. Le 5 mai dernier, des forces nigériennes perquisitionnent les bureaux d’Orano à Niamey. Elles saisissent des équipements et emmènent Ibrahim Courmo, directeur local, dont on ignore le sort. Orano dénonce une arrestation arbitraire et porte plainte le 13 mai. Face à ces pressions, l’entreprise envisage de céder ses mines, notamment celle de Somaïr, à d’autres acteurs.
Ce divorce s’inscrit dans une crise plus large. En juillet 2023, un coup d’État porte le général Abdourahamane Tiani au pouvoir. L’armée adopte une politique nationaliste, visant à contrôler les ressources du pays. L’uranium, qui génère 7% du PIB nigérien, est une priorité. En juin 2024, le gouvernement révoque le permis d’Orano pour la mine d’Imouraren. En décembre, il prend le contrôle de Somaïr, bloquant 1 150 tonnes d’uranium, soit 200 à 300 millions d’euros. Ces mesures traduisent une volonté de souveraineté économique.
Les contrats miniers, négociés après l’indépendance en 1960, alimentent les tensions. Ils accordent au Niger seulement 15 à 20% des revenus de l’uranium, bien moins que dans d’autres pays comme le Canada. Niamey critique ces accords, perçus comme un héritage de l’influence française. Elle cherche de nouveaux partenaires, comme la Russie ou l’Iran, mais aucun accord n’a été confirmé récemment.
Pour le Niger, nationaliser l’uranium est un pari risqué. Le pays, parmi les plus pauvres au monde, dépend de ce minerai. La fermeture de la frontière terrestre avec le Bénin bloque les exportations. À Arlit, où Somaïr emploie 780 personnes, les habitants redoutent des pertes d’emplois. La pollution des eaux par les déchets radioactifs complique encore la situation.
Orano, malgré ces défis, reste solide. En 2024, son chiffre d’affaires atteint 5,9 milliards d’euros, en hausse de 23%, grâce à des contrats au Japon. L’entreprise se tourne vers la Mongolie, le Canada et la Namibie pour ses futures mines. Son PDG, Nicolas Maes, affirme que l’entreprise peut se passer du Niger, qui représente 4,7% de la production mondiale d’uranium.
Ce conflit dépasse l’économie. Depuis 2023, le Niger s’éloigne de la France, expulsant ses troupes et se rapprochant de Moscou. L’Europe, qui importait 25% de son uranium du Niger, doit trouver d’autres sources. Une entrée de la Russie ou de la Chine dans le secteur nigérien pourrait redessiner le marché mondial.
L’avenir reste incertain. Orano a lancé un arbitrage international contre le Niger. La vente de ses actifs, si elle se concrétise, pourrait attirer de nouveaux investisseurs. Mais à Arlit, les travailleurs s’inquiètent. À Niamey, les militaires misent sur la souveraineté. À Paris, Orano prépare son retrait.
Ce bras de fer reflète une ambition croissante en Afrique : contrôler ses ressources. Le Niger pourrait inspirer d’autres pays. Mais sans partenaires fiables ni gestion rigoureuse, ce rêve risque de s’essouffler.