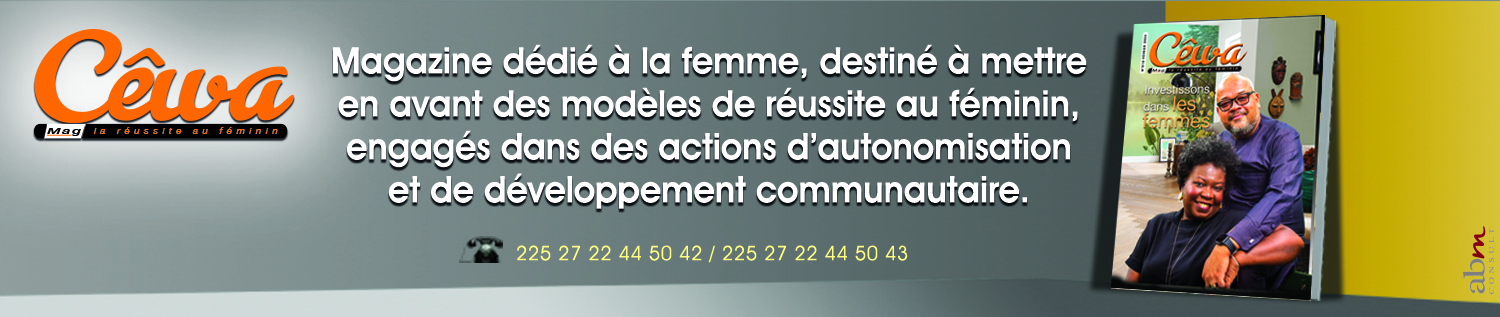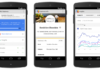Confronté à une dette publique croissante, à une baisse de l’aide extérieure et à une colère sociale persistante, le président kényan William Ruto mise sur un vaste plan de privatisations et d’ouverture au capital privé pour relancer l’économie. L’introduction en Bourse de la Kenya Pipeline Company en 2025 incarne cette stratégie ambitieuse mais semée d’embûches.
Une ouverture vers les marchés financiers
Le 1er juillet 2025, à la Bourse de Londres, le président William Ruto a dévoilé un programme de privatisation d’une ampleur inédite au Kenya. Il prévoit notamment l’introduction en Bourse de la Kenya Pipeline Company (KPC), entreprise publique stratégique du secteur énergétique. L’objectif est double : stimuler les investissements privés et réduire la dépendance du pays à l’endettement extérieur. Cette orientation marque une inflexion majeure dans la politique économique kényane, centrée désormais sur la mobilisation des ressources internes via le marché financier local, en particulier la Nairobi Securities Exchange (NSE).
La Kenya Pipeline Company en fer de lance
C’est la KPC qui devrait ouvrir le bal des introductions en Bourse dès 2025. Cette société publique, qui contrôle le réseau de pipelines pétroliers du pays, présente un profil attractif aux yeux des investisseurs : elle génère des revenus stables et dispose d’actifs tangibles. Pour le gouvernement, cette opération a valeur de test. Elle vise à démontrer que des entreprises publiques peuvent être rentables, bien gérées et ouvertes au capital privé sans perdre leur vocation stratégique. Elle pourrait ainsi servir de modèle pour d’autres entités étatiques, dans des secteurs aussi variés que l’énergie, les transports ou la logistique.
Un contexte économique sous pression
Cette stratégie intervient dans un climat économique tendu. La dette publique du Kenya devrait atteindre 65,5 % du PIB en 2025, selon la Banque mondiale. Après des années de recours massif aux marchés internationaux, le gouvernement est confronté à une hausse des coûts d’emprunt et à un durcissement des conditions d’accès au financement. En 2024, la tentative d’augmenter les impôts pour lever 2,68 milliards de dollars a provoqué des manifestations massives, forçant l’exécutif à revoir sa copie budgétaire. À cela s’ajoute la décision du président américain Donald Trump, début 2025, de suspendre l’aide de l’USAID au Kenya, accroissant encore la pression sur les finances publiques.
Titrisation : un mécanisme au cœur de la relance
Au-delà des privatisations classiques, le gouvernement kényan mise sur la titrisation pour lever rapidement des capitaux. Ce mécanisme consiste à transformer des actifs publics générateurs de revenus (comme les péages routiers ou les redevances hospitalières) en titres financiers, vendus à des investisseurs. Ces titres sont émis par une entité juridique dédiée, appelée Special Purpose Vehicle (SPV), et permettent de lever des fonds immédiats en contrepartie de flux de trésorerie futurs.
Le Kenya a déjà levé 1,3 milliard de dollars via ce procédé. L’intention de coter ces obligations sur la NSE vise à élargir la base d’investisseurs, notamment locaux, et à renforcer la profondeur du marché financier. Pour le président Ruto, il s’agit de créer un écosystème dynamique où les capitaux privés remplaceraient progressivement les emprunts extérieurs dans le financement des infrastructures.
Un marché de capitaux à structurer
Cette ouverture vers la finance de marché pourrait marquer un tournant pour la NSE, encore peu développée à l’échelle continentale. En attirant des investisseurs institutionnels et particuliers, le gouvernement espère favoriser une meilleure allocation de l’épargne nationale. Des projets en partenariat public-privé, notamment dans la santé ou l’énergie, pourraient ainsi être financés par des redevances à l’utilisation, générant les revenus nécessaires à la titrisation.
Mais cette stratégie n’est pas sans risques. Si les revenus issus des actifs titrisés – comme les recettes de péage – s’avèrent inférieurs aux projections, les investisseurs pourraient subir des pertes. Par ailleurs, la transparence du dispositif et la solidité du cadre réglementaire seront déterminantes pour instaurer la confiance. La Capital Markets Authority (CMA), autorité de régulation du secteur, est appelée à jouer un rôle clé, mais elle devra sans doute renforcer ses capacités pour faire face à ces nouveaux instruments financiers.
Des incertitudes juridiques persistantes
Un autre frein majeur réside dans le flou juridique qui entoure actuellement le processus. En septembre 2024, la Haute Cour kényane a jugé la loi sur la privatisation de 2023 inconstitutionnelle, pointant un défaut de consultation publique. Cette décision a bloqué la vente de 35 entreprises publiques, dont la KPC. Bien que le gouvernement ait interjeté appel, cette invalidation fragilise l’ensemble du programme. Elle illustre également les limites de la démarche top-down du gouvernement, souvent critiquée pour son manque de concertation.
Un pari économique et politique
L’ambition du président Ruto est claire : faire de la privatisation et de la titrisation des leviers de souveraineté financière. Mais le succès de cette stratégie dépendra de plusieurs facteurs : la capacité à lever des fonds sans céder le contrôle stratégique des entreprises, la gestion efficace des flux financiers associés aux SPV, la solidité des institutions de régulation, et surtout, la perception du public.
Car en toile de fond, une question subsiste : comment concilier attractivité pour les investisseurs et acceptabilité sociale, dans un pays où l’économie informelle demeure massive et où la défiance envers les élites politiques reste forte ? L’introduction en Bourse de la KPC pourrait être un signal fort – ou au contraire, un révélateur des limites d’une stratégie ambitieuse mais fragile.