L’Organisation des Nations Unies (ONU) traverse une tempête financière. Confrontée à des réductions majeures de l’aide étrangère américaine, son principal bailleur de fonds, l’organisation planche sur une réforme structurelle d’envergure. Objectif : rationaliser ses opérations pour survivre dans un contexte de ressources en chute libre. Mais cette refonte, encore au stade de projet, soulève autant d’espoirs que de questions.
Une dépendance financière sous tension
L’ONU repose sur les contributions de ses 193 États membres, mais les États-Unis jouent un rôle démesuré. En 2024, ils ont fourni environ 22% du budget régulier de l’ONU (3,5 milliards de dollars) et près d’un tiers des fonds pour les opérations de maintien de la paix. Ce soutien, toutefois, s’érode. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les coupes budgétaires se multiplient. Un décret signé le 4 février 2025 ordonne une réévaluation complète de la participation américaine à l’ONU, qualifiée d’« inefficace » par le président. Résultat : des agences comme le Programme alimentaire mondial (PAM) font face à des réductions draconiennes, avec des suppressions d’emplois prévues pour 25 à 30% de leurs effectifs mondiaux.
Ces coupes ne sont pas anodines. Le PAM, qui nourrit des millions de personnes dans des zones de crise, pourrait réduire ses opérations dans des pays comme le Yémen ou le Soudan. Pour l’ONU, la perte de fonds américains menace non seulement ses programmes, mais aussi sa crédibilité face à des critiques croissantes sur sa gestion.
Une refonte pour sauver l’ONU ?
Face à cette crise, une équipe de hauts responsables onusiens a élaboré un plan ambitieux. Selon une note interne consultée par l’agence Reuters, l’ONU envisage de regrouper ses dizaines d’agences, souvent critiquées pour leur dispersion, en quatre grands départements : paix et sécurité, affaires humanitaires, développement durable, et droits de l’homme. Cette réforme vise à éliminer les doublons, réduire les coûts administratifs et optimiser l’utilisation des ressources. Actuellement, l’ONU compte plus de 30 agences, fonds et programmes, chacun avec ses propres structures et priorités. Cette fragmentation, selon les experts, entraîne des inefficacités coûteuses.
La note interne pointe également une inflation des postes de direction, qui alourdit le budget sans améliorer les résultats. En regroupant les agences, l’ONU espère non seulement faire des économies, mais aussi répondre aux critiques des pays donateurs, États-Unis en tête, qui exigent plus de transparence et d’impact.
Les enjeux économiques d’une réforme
Sur le plan économique, cette refonte est un pari risqué. D’un côté, une structure plus légère pourrait permettre à l’ONU de mieux allouer ses fonds aux priorités globales : lutte contre la faim, changement climatique, ou crises humanitaires. Par exemple, une coordination renforcée entre agences pourrait accélérer les réponses aux catastrophes, comme les récents cyclones en Asie du Sud-Est. De l’autre, la transition vers un nouveau modèle s’annonce coûteuse et complexe. La fusion d’agences risque de provoquer des résistances internes, tandis que les suppressions de postes pourraient affecter l’expertise de l’organisation.
Pour les pays en développement, qui dépendent des programmes onusiens, les conséquences sont incertaines. Une ONU plus efficace pourrait mieux cibler l’aide, mais des budgets réduits limiteront de toute façon son impact. En 2024, le PAM a déjà réduit ses rations alimentaires dans plusieurs pays africains faute de fonds. Si les coupes américaines se confirment, d’autres agences, comme l’UNICEF ou le Haut-Commissariat pour les réfugiés, pourraient suivre.
Un bras de fer géopolitique
Au-delà des aspects économiques, la refonte de l’ONU s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu. Les États-Unis, en réduisant leur engagement, envoient un signal clair : l’organisation doit se réformer ou risquer de perdre son influence. Mais cette pression pourrait aussi exacerber les divisions entre membres. Des pays comme la Chine ou la Russie, qui critiquent l’hégémonie occidentale à l’ONU, pourraient chercher à combler le vide financier laissé par Washington, renforçant leur influence.
La réforme, si elle aboutit, redessinera le fonctionnement de l’ONU pour les décennies à venir. Mais son succès dépendra de la capacité des États membres à s’entendre sur une vision commune, une tâche ardue dans un monde fracturé.
Vers un avenir incertain
L’ONU se trouve à un tournant. Les réductions de l’aide américaine l’obligent à repenser son modèle, mais la route vers une organisation plus efficace est semée d’embûches. La proposition de fusionner les agences en quatre départements est un premier pas, mais sa mise en œuvre reste hypothétique. En attendant, les victimes des crises mondiales – réfugiés, affamés, déplacés – risquent de payer le prix de cette incertitude.
Pour l’ONU, le défi est double : prouver qu’elle peut se réinventer tout en continuant à répondre aux besoins urgents d’un monde en crise. Une chose est sûre : sans réforme, son rôle de pilier de la coopération internationale pourrait s’effriter.

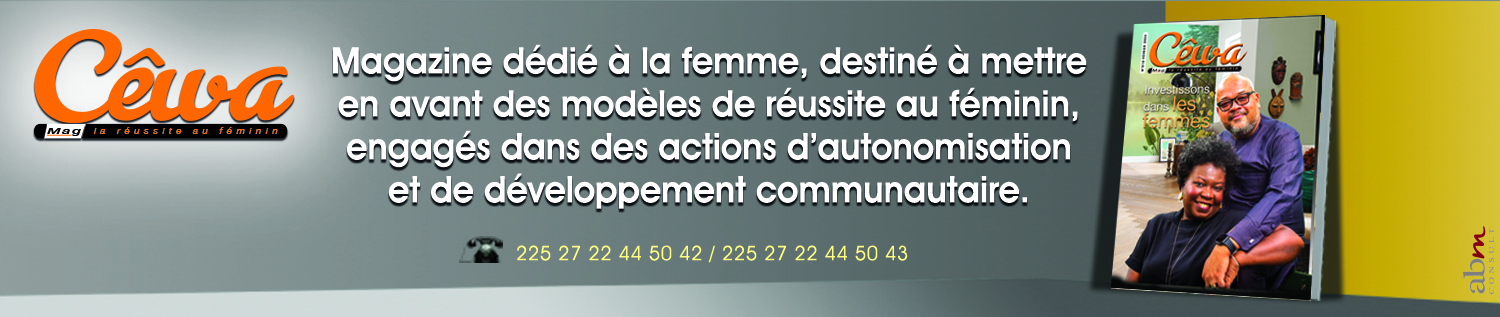






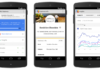




ygqjb6