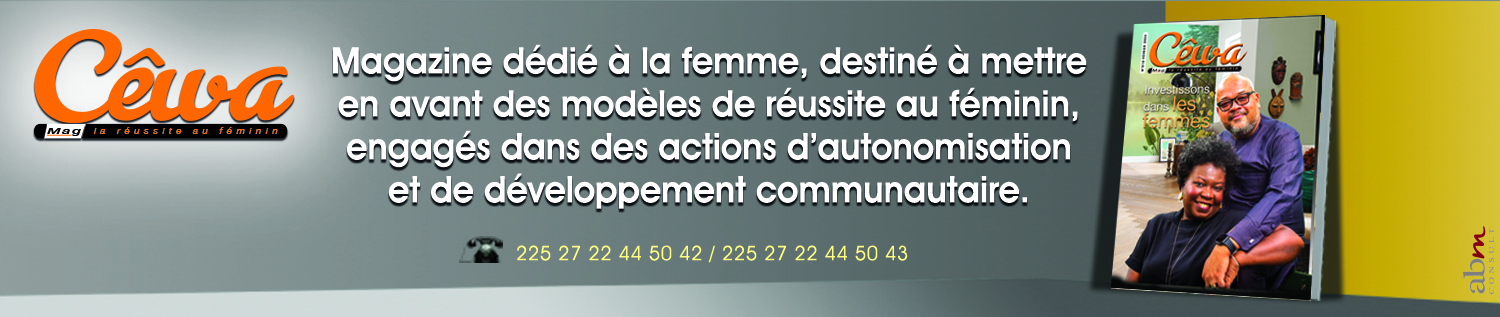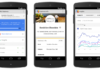Alors que la pression démographique, le changement climatique et la déforestation fragilisent les équilibres socio-économiques de l’Afrique de l’Ouest, le Bénin amorce un virage stratégique. Avec un financement de 180,7 millions de dollars (104,9 milliards FCFA) approuvé par la Banque mondiale, le pays s’engage dans une double réforme ambitieuse : moderniser son administration foncière et restaurer ses forêts classées. Deux leviers décisifs pour structurer son développement sur le long terme.
Dans les zones rurales béninoises, la terre est bien plus qu’un simple actif : elle représente la mémoire, la survie, et souvent, l’unique héritage transmis de génération en génération. Pourtant, la majorité des parcelles échappent encore à toute reconnaissance légale. Les conflits fonciers y sont fréquents, étouffant les ambitions agricoles et freinant les investissements. Avec un premier financement de 100 millions de dollars, le programme national Terra Bénin entend briser ce cercle vicieux en enregistrant officiellement un million de parcelles sur 1,5 million cartographiées dans 14 communes.
L’innovation ne se limite pas à la technique. En intégrant des données climatiques à la plateforme numérique e-Foncier Bénin, les autorités veulent anticiper les catastrophes naturelles et rendre la gestion foncière plus résiliente. Pour de nombreux petits exploitants, ce n’est pas une simple avancée administrative : c’est l’espoir d’un crédit bancaire, la possibilité d’investir sans peur, et la garantie de transmettre légalement leur terre à leurs enfants. À travers cette dynamique, c’est toute une économie agricole que le gouvernement cherche à structurer sur des bases solides.
Parallèlement, un second appui de 80,7 millions de dollars va donner un nouvel élan à la restauration des forêts classées. Il ne s’agit pas seulement de planter des arbres, mais de reconstruire des écosystèmes vivants, utiles, et générateurs de revenus. La phase précédente a permis la reforestation de 26 000 hectares, tout en piégeant près de 3 millions de tonnes d’équivalent CO2. Plus de 50 000 personnes, dont de nombreuses femmes, ont vu leur quotidien transformé par les revenus issus de l’agroforesterie ou de la valorisation de produits comme le miel ou les fruits sauvages.
Forte de ces résultats, la nouvelle phase prévoit de restaurer 20 000 hectares supplémentaires. Mais au-delà des chiffres, c’est une transformation silencieuse qui s’opère : des communautés se réapproprient leur environnement, redonnent vie à des terres abandonnées, et deviennent actrices de leur propre développement. En parallèle, le pays explore des opportunités sur le marché international des crédits carbone, avec l’ambition de transformer la séquestration de CO2 en nouvelle source de revenus pour les zones rurales.
L’articulation de ces deux programmes reflète une vision intégrée et profondément humaine du développement : protéger les terres, restaurer les forêts, et, à travers cela, donner aux populations les moyens de résister aux chocs, de sortir de la pauvreté, et de bâtir un avenir plus stable. Ce pari sur le long terme, s’il est tenu avec rigueur et transparence, pourrait inspirer bien au-delà des frontières béninoises, là où la précarité foncière, la déforestation et l’exclusion économique restent des défis communs.
Comme l’a souligné Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, « ces financements appuient une vision intégrée du développement, qui allie modernisation des services publics et préservation du capital naturel ». Une vision à consolider pour que les promesses de la transition verte ne restent pas lettres mortes.