Opinion / Mines d’or au Burkina : Vers une exploitation rentable et responsable ou nouveau risque de rente extractive ?
Le 23 octobre 2025, le gouvernement burkinabè a
ratifié un prêt de 30 milliards FCFA (53,1 millions de dollars) accordé par la
Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) pour « renforcer les capacités
opérationnelles » des mines de Boungou et Wahgnion. Le coût total du projet est
estimé à 33,21 milliards FCFA, la contrepartie nationale étant de 3,21
milliards FCFA.
Un financement qui change-t-il le modèle
d’exploitation ?
Sur le papier, oui. Le projet cible quatre volets
opérationnels : achat d’équipements modernes (foration, extraction, transport,
production), sécurisation et assèchement des fosses à Boungou, rehaussement du
parc à résidus et raccordement électrique, ainsi que la construction d’une phase
1 d’un parc à résidus de 2,4 millions de tonnes et d’une ligne électrique de 76
km pour Wahgnion. Ces investissements peuvent améliorer le rendement et la
sécurité technique des sites.
Mais la modernisation des moyens techniques ne
suffit pas à elle seule à renverser un modèle extractif classique. Trois
éléments clés détermineront si ce financement mutera en création de valeur
locale ou reste une simple pompe à production pour revenus d’État :
1.
Clauses d’intégration locale : pour transformer le modèle, le contrat doit prévoir des obligations
claires — pourcentages d’achats locaux, quotas d’embauche locale et programmes
de formation.
2.
Transferts technologiques : acquisition d’équipements + plan de formation conduisent à des emplois
qualifiés durables.
3.
Partage des revenus : mécanismes transparents pour canaliser une partie des recettes vers le
développement local (infrastructures, santé, éducation).
À ce stade, ni la BOAD ni le Gouvernement n’ont
rendu publics les détails contractuels (taux, maturité, conditions de
remboursement, ou clauses sociales et environnementales). Sans ces éléments, la
modernisation reste incomplète sur le plan sociétal et économique.
Effet attendu sur l’économie locale et nationale
Les gains potentiels sont concrets : hausse de la
productivité, amélioration de la récupération d’or, recettes fiscales accrues
et infrastructures (électricité) pouvant bénéficier aux populations riveraines.
Si la ligne électrique et les travaux sont mis en place, on peut voir un effet
d’entraînement : meilleures routes, approvisionnement électrique, et
opportunités pour PME locales (maintenance, logistique, services).
Mais attention : ces effets positifs sont
conditionnels. Les questions à trancher sont notamment :
- Combien d’emplois permanents seront créés ? Combien de formation
locale ?
- Quelle part des marchés (fournitures, maintenance) ira aux PME
burkinabè ?
- Les recettes supplémentaires seront-elles affectées à des projets
publics locaux mesurables ?
Sans réponses publiques à ces questions, le
bénéfice macroéconomique reste hypothétique.
Garanties pour que collectivités et environnement
ne soient pas les perdants
La mention d’un parc à résidus et des opérations
d’assèchement est positive — mais la promesse vaut si elle repose sur une ESIA
(Évaluation d’Impact Environnemental et Social) robuste, publique et suivie.
Autrement dit : décisions techniques + obligations contractuelles + contrôle
citoyen. Points essentiels :
- Publication et contrôle de l’ESIA :
mesurer les risques sur nappes phréatiques, biodiversité et terres
agricoles.
- Comités locaux de suivi :
impliquer collectivités, ONG et autorités indépendantes pour suivre
l’application des mesures d’atténuation.
- Fonds de développement local :
mécanisme budgétaire dédié et transparent alimenté par une fraction des
recettes minières pour compenser impacts et financer infrastructures.
Les précédents montrent qu’un parc à résidus mal
géré devient une source durable de pollution et de conflit. Le Burkina a déjà
traversé des épisodes où la gouvernance minière a été mise à l’épreuve :
nationalisations, réformes du code minier et tensions avec investisseurs
étrangers montrent que le cadre institutionnel évolue fortement. Il faut donc
des garanties contractuelles explicites et des moyens de contrôle indépendants.
Rôle des entreprises locales et des PME
La modernisation offre une fenêtre d’opportunité
pour les entreprises locales, à condition qu’elles soient intégrées dès la
conception du projet. Les leviers pratiques :
- Clauses d’achats locaux dans les
marchés publics pour équipements non spécialisés et services
(restauration, transport, sécurité non armée).
- Pépinières de sous-traitants :
programmes de montée en compétence subventionnés (maintenance mécanique,
électrique, logistique).
- Accès au crédit :
faciliter les garanties et lignes de crédit (banques locales,
microfinance) pour que les PME puissent répondre aux marchés miniers.
Sans politique industrielle minière volontariste,
la chaîne de valeur restera capturée par fournisseurs étrangers ou grandes
firmes internationales, limitant les retombées locales.
Risques majeurs à surveiller
1.
Transparence financière : absence de détails publics sur le prêt (taux, maturité, conditions) crée
un risque budgétaire. Les contrats doivent être rendus publics ou au moins
soumis à une revue parlementaire.
2.
Sécurité : la persistance d’insécurité dans certaines zones du Burkina alourdit les
coûts et peut interrompre la production. Les décideurs doivent intégrer des
scénarios de risque et des garanties d’assurance.
3.
Rente sans développement : si l’État capte les recettes sans investissements ciblés pour le
développement local, la population ne verra pas d’amélioration tangible —
facteur potentiel de frustration sociale.
Vers quel modèle penche-t-on ?
Le prêt BOAD est un signal politique et financier
fort : l’État veut remettre en valeur des actifs qu’il contrôle et moderniser
la production. C’est une bonne nouvelle technique. Mais la transformation
structurelle (plus de valeur locale, emplois durables, protection de
l’environnement) dépend entièrement des clauses et mécanismes de gouvernance
autour du financement et de l’exécution. Sans ces garde-fous, le projet risque
de renforcer la rente extractive plutôt que d’installer une chaîne de valeur
inclusive.





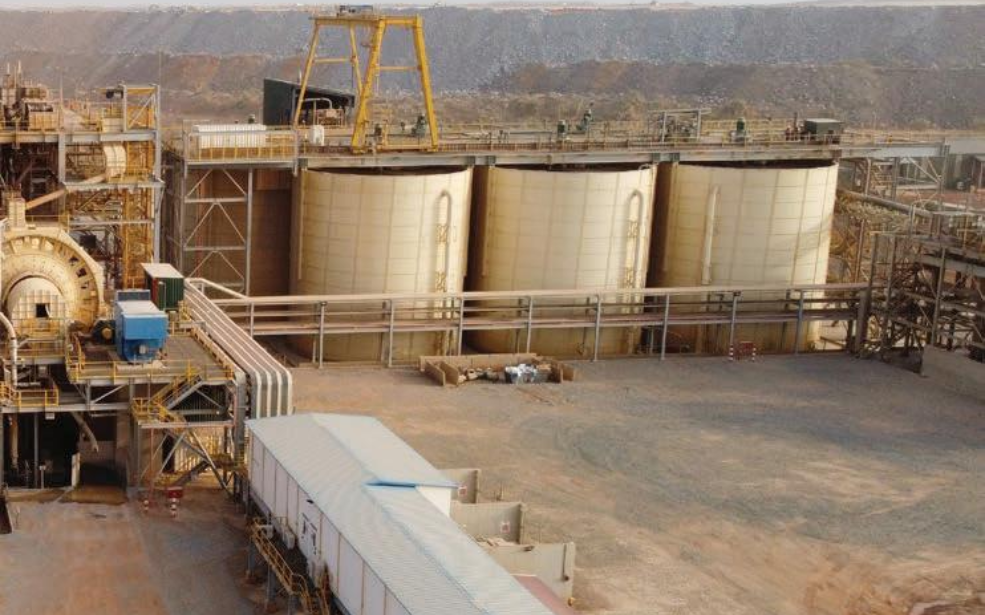








Zinia Farnandiz Sep 28, 2024
Absolutely loved this post! Your tips on how to style a blazer are spot on. Keep up the great work, can’t wait for your next post!
Loren Watson Sep 18, 2024
Cover broad of topic in web development industry. Explained a lot of basic programming knowledge with easy to understand explanation.
Walter White Sep 29, 2024
Employees who have the flexibility to work remotely often report higher job satisfaction. This can lead to increased employee retention workforce.