États-Unis : La chasse aux financiers de l’État islamique en Afrique s’intensifie
Les États-Unis, en collaboration avec plusieurs
pays du Golfe, ont annoncé le 15 juillet 2025 des sanctions financières ciblées
contre trois ressortissants africains soupçonnés de soutenir l’État islamique
(EI) sur le continent. Une stratégie qui vise à tarir les ressources des
réseaux terroristes actifs en Afrique, en misant sur la coopération
internationale et le gel des avoirs.
Des profils identifiés dans plusieurs régions
d’Afrique
Le Trésor américain, par le biais de l’Office of
Foreign Assets Control (OFAC), a inscrit sur sa liste noire trois individus
soupçonnés de jouer un rôle central dans le financement de groupes affiliés à
l’EI. L’opération s’est faite dans le cadre du Centre contre le financement du
terrorisme (TFTC), une coalition réunissant les États-Unis, l’Arabie saoudite,
les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Oman et Bahreïn.
Parmi les personnes visées, figure Hamidah
Nabagala, une ressortissante ougandaise installée en République démocratique du
Congo (RDC). Selon l’OFAC, elle aurait servi d’intermédiaire entre des
bailleurs de fonds et les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé
actif dans l’Est de la RDC, affilié à l’État islamique depuis 2017. Nabagala
est également suspectée d’avoir contribué au financement de l’attentat de
Kampala en 2021, qui a causé plusieurs morts dans la capitale ougandaise.
Autre cible des sanctions : Zayd Gangat, citoyen
sud-africain, connu des services de renseignement. Il est accusé d’avoir mis en
place un réseau de financement pour l’EI en Afrique du Sud, reposant sur des
activités criminelles telles que le racket, les enlèvements et les braquages.
Le Trésor américain le soupçonne aussi d’être impliqué dans le recrutement et
la formation de combattants pour le compte de l’organisation terroriste.
L’Afrique du Sud, dont le système bancaire est sophistiqué mais la régulation
parfois jugée permissive, est depuis plusieurs années considérée comme une
plateforme logistique potentielle pour les réseaux djihadistes.
Le troisième individu sanctionné, Abdiweli
Mohamed Yusuf, est un Somalien présenté comme un haut responsable de la branche
locale de l’EI. Il serait chargé de la logistique liée au transport d’armes, de
munitions et de combattants étrangers vers les zones contrôlées par
l’organisation en Somalie, où elle reste en concurrence avec les militants
d’al-Shebab.
Des sanctions coordonnées et à portée immédiate
Les trois individus sont désormais désignés comme
Specially Designated Global Terrorists (SDGT), en vertu du décret exécutif
américain 13224. Cette désignation permet le gel immédiat de leurs avoirs aux
États-Unis ou dans tout établissement financier relevant de la juridiction
américaine, ainsi que l’interdiction pour toute entité américaine de traiter
avec eux. Les États membres du TFTC se sont également engagés à appliquer des
mesures similaires sur leur territoire.
Le sous-secrétaire au Trésor américain chargé du
terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, a souligné que ces
mesures visent à démontrer « l’engagement [des États-Unis] à couper les lignes
de financement des réseaux terroristes, où qu’ils se trouvent ». Les
plateformes de transfert d’argent, les banques commerciales et les institutions
numériques sont appelées à intensifier leurs contrôles et à bloquer toute
opération suspecte liée à ces personnes.
Une pression croissante sur les États africains
Au-delà des sanctions, cette action diplomatique
et financière constitue un signal adressé aux États africains concernés. Les
États-Unis et leurs partenaires espèrent susciter une réaction concrète de la
part des gouvernements de la RDC, de l’Ouganda, de la Somalie et de l’Afrique
du Sud, à travers l’ouverture d’enquêtes, des arrestations ou des poursuites
judiciaires.
Le financement du terrorisme passe souvent par
des circuits difficiles à identifier : réseaux informels, transferts de fonds
non déclarés, systèmes de prête-noms, voire recours aux cryptomonnaies. Dans un
rapport de 2024, le Groupe d’action financière (GAFI) alertait déjà sur le
recours croissant à ces mécanismes en Afrique pour échapper à la surveillance
des États et des institutions bancaires.
En ciblant les mécanismes financiers, les
autorités espèrent assécher progressivement les ressources logistiques des
groupes armés. Cette approche, plus discrète que les opérations militaires
classiques, permet d’identifier les soutiens économiques et les complicités qui
nourrissent l’instabilité sécuritaire.
Une guerre de l’ombre aux ramifications globales
L’opération du 15 juillet pourrait être la
première d’une série. D’autres sanctions sont à l’étude, selon plusieurs
responsables américains. Les banques africaines, les ONG et les entreprises
locales sont invitées à renforcer leurs dispositifs de contrôle, en lien avec
des institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale.
Loin des champs de bataille, une autre guerre se
joue désormais dans les coulisses : celle du renseignement financier. Elle
implique les régulateurs, les cellules anti-blanchiment, les plateformes de
paiement et les autorités de supervision bancaire. À ce titre, Elizabeth
Rosenberg, secrétaire adjointe au Trésor, rappelait récemment que « les réseaux
financiers terroristes s’adaptent, se numérisent et se déplacent. Notre réponse
doit être tout aussi agile. »









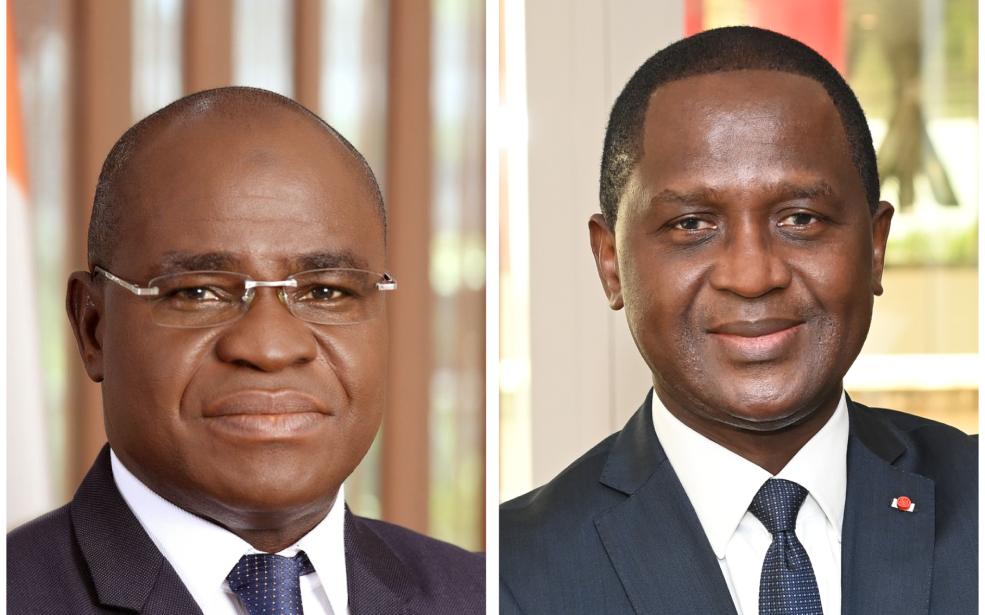




Zinia Farnandiz Sep 28, 2024
Absolutely loved this post! Your tips on how to style a blazer are spot on. Keep up the great work, can’t wait for your next post!
Loren Watson Sep 18, 2024
Cover broad of topic in web development industry. Explained a lot of basic programming knowledge with easy to understand explanation.
Walter White Sep 29, 2024
Employees who have the flexibility to work remotely often report higher job satisfaction. This can lead to increased employee retention workforce.