Opinion : À Bamako, le silence des moteurs devient trop long
À quelques kilomètres de l’embarcadère des
camions-citernes, à Bamako, on patiente. Des files de motos s’égrènent devant
les rares stations ouvertes, le temps s’étire, le carburant se raréfie. Le
paysage ressemble peu à peu à un seuil d’alerte : plus exactement, il l’est.
Car depuis début septembre 2025, la capitale du Mali et de nombreuses villes du
pays sont confrontées à une crise énergétique qui prend une dimension
économique et stratégique.
1. Le déclencheur : l’arme silencieuse du blocage
C’est le Jama'at Nusrat al‑Islam wal‑Muslimin
(JNIM) — affilié à Al‑Qaïda — qui a enclenché la bascule. En début septembre,
le groupe a annoncé une mise à l’arrêt des importations de carburant vers le
Mali — essence et diesel confondus — en provenance de pays voisins comme le
Sénégal, la Côte d’Ivoire ou la Guinée.
Quelques jours plus tard, au moins 40 citernes ont été détruites lors d’une
attaque sur un convoi militaire-escorte dans la région de Kayes.
Le message est devenu clair : attaquer la logistique énergétique d’un pays peut
s’apparenter à un levier de pression sur son économie.
Crise du carburant au Mali
2. La vulnérabilité structurelle : un pays à cœur
importateur
Le Mali importe plus de 95% de ses produits
pétroliers, ce qui expose l’économie à tout bris de chaîne d’approvisionnement.
Le pays ne dispose pas de raffinerie suffisante ni de multiples corridors
d’importation sécurisés. Résultat : un réseau dépendant, vulnérable à la
moindre interruption logistique — et l’interruption est bien là.
Les convois de carburant, qu'ils soient destinés
à l’usage domestique ou à l’industrie minière, sont désormais soumis à
escortes, retards, voire blocages. Exemple : l’armée malienne a retenu environ 70
camions-citerne destinés à la mine de Sadiola au début octobre.
Quand l’oxygène énergétique se fait rare, tout l’écosystème transversal en
ressent les effets.
3. Les signes visibles de la crise – octobre 2025
Dès début octobre, le phénomène devient tangible
:
- Dans la capitale, des stations-service de grandes enseignes (Shell,
Total, Star) ferment ou ne proposent plus que du diesel.
- Les files s’allongent. Témoignage : « J’ai poussé ma moto sur six
kilomètres pour rien », rapporte un utilisateur à Bamako.
- L’énergie électrique vacille. Des centrales thermiques tombent à
quelques heures de production faute de carburant.
L’économie réelle commence à souffler fort :
transport, logistique, petites industries, commerces. Le coût du déplacement
grimpe, les coûts de production augmentent, les chaînes logistiques
s’enraillent.
4. Les effets économiques et sociaux
Parce que la crise n’est pas que technique : elle
est profondément économique.
- Pour les ménages, chaque litre manquant devient un détour, une
angoisse, un surcoût. Ce qui était banal devient contraignant.
- Pour les entreprises, c’est un coup au cœur : transport plus cher,
production ralentie, investissement remis à plus tard.
- Pour l’État, c’est un test de légitimité : assurer l’approvisionnement
est un des piliers de la souveraineté. Quand ce pilier vacille, c’est
toute la stabilité qui est remise en question.
- Pour les secteurs clés, comme les mines, l’impact est direct : des
transports bloqués, des activités à l’arrêt. Exemple : la mine de Sadiola
dépend fortement des flux de carburant.
En filigrane, l’on voit la vulnérabilité d’un
modèle économique encore trop dépendant, trop peu résilient.
1.
Lecture – ce que cette crise
dit du Mali et de l’Afrique de l’Ouest
- Un pays importateur quand le monde vacille est une cible facile. Le
Mali le découvre trop tard.
- Un blocage logistique équivaut à un choc d’offre : la demande est là,
mais l’offre ne parvient pas. Cette asymétrie génère l’inflation, la
raréfaction, l’instabilité.
- La montée de groupes armés capables d’affecter l’économie nationale
pose un nouveau paradigme : l’économie devient un champ de bataille.
- La région ouest-africaine est interconnectée : un corridor bloqué ici,
c’est des effets là-bas. Ce n’est pas seulement le Mali, c’est une alerte
pour toute la sous-région.
5. L’enjeu pour l’agriculture, l’entrepreneuriat
et le développement
Pour nous, qui suivons le financement, le
développement, l’entrepreneuriat en Afrique : c’est un moment charnière.
- Une micro-entreprise fonctionnant sur le transport routier voit son
coût grimper brutalement.
- Une ferme ou un producteur dépendant du diesel pour irriguer ou
acheminer ses produits est désormais plus fragile.
- Le financement de ces acteurs doit prendre en compte cette volatilité
énergétique. On ne peut pas davantage ignorer l’instabilité du « carburant
» comme variable stratégique.
6. Et maintenant ? Les pistes à suivre
À court terme : sécuriser les corridors
d’importation, mettre en place des stocks tampons, multiplier les voies
d’acheminement.
À moyen terme : diversifier les sources d’énergie
; envisager davantage de solaire, biocarburants, ou solutions hybrides dans les
zones rurales.
À long terme : repenser le modèle énergétique
pour qu’il soit moins importateur‐vulnérable, plus résilient, plus régional.
Tout cela est aussi un appel à l’intégration régionale, à la coopération
logistique entre États, et à des politiques publiques capables d’anticiper les
ruptures.
En somme, la crise du carburant au Mali n’est pas un choc
isolé. C’est un symptôme : celui d’un modèle économique peu résilient, d’une
logistique fragile, d’une souveraineté énergétique floue. Pour les
entrepreneurs, les agriculteurs, les financiers, c’est un signal fort :
l’énergie ne se négocie pas seulement à la pompe, elle se négocie dans les
choix structurels.
Le silence des moteurs à Bamako n’est donc pas seulement le bruit d’un arrêt.
Il est le signal d’alarme d’un système qui doit muter — et vite.







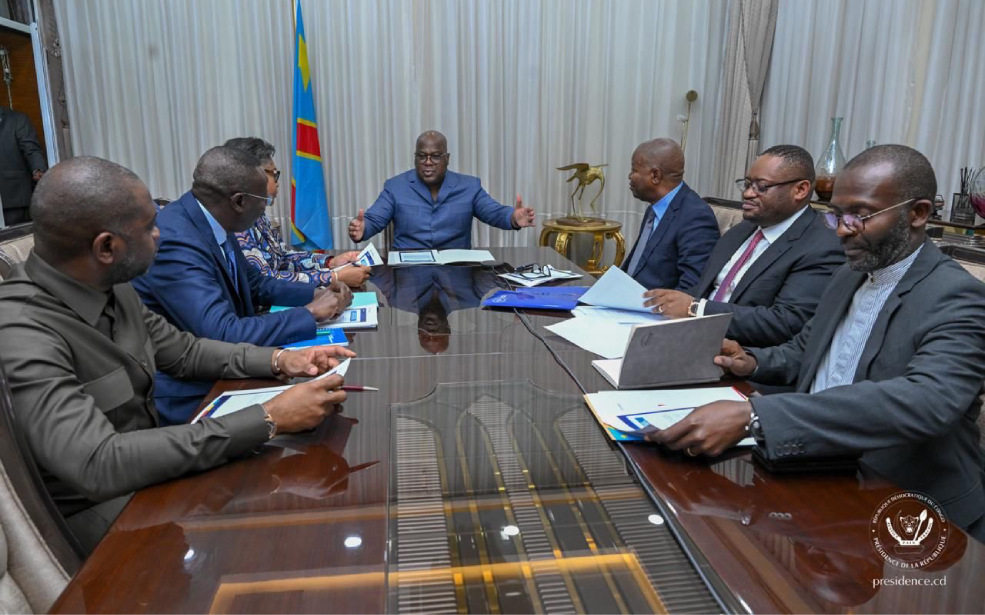






Zinia Farnandiz Sep 28, 2024
Absolutely loved this post! Your tips on how to style a blazer are spot on. Keep up the great work, can’t wait for your next post!
Loren Watson Sep 18, 2024
Cover broad of topic in web development industry. Explained a lot of basic programming knowledge with easy to understand explanation.
Walter White Sep 29, 2024
Employees who have the flexibility to work remotely often report higher job satisfaction. This can lead to increased employee retention workforce.